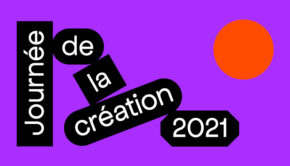Sur le tournage de Rosebud d’Otto Preminger
En 1973, au terme de quelques entretiens destinés à la mise en chantier d’un travail d’ensemble sur Otto Preminger, j’avais sollicité de ce dernier la possibilité d’assister au tournage du film dont il commençait alors la préparation, Implosion, d’après le livre de Louis Nizer consacré aux Rosenberg. Lorsque ce projet fut ajourné pour céder la place à Rosebud, je renouvelai ma demande et reçus de Preminger l’autorisation de suivre la partie française du tournage, puis, très rapidement, une invitation à assister à l’ensemble de la réalisation. Cette offre généreuse ne fut accompagnée d’aucune question quant au contenu et au caractère du témoignage que je serais amené à faire. Ceux qui ont assisté à des tournages et connaissent l’atmosphère de secret paranoïde dont aiment à s’entourer certains réalisateurs, mesureront sans doute à cette seule indication le désir d’ouverture de Preminger, et cette volonté de travailler « à découvert » qui constitue un des aspects les plus saillants de sa personnalité. Ces quelques pages sont extraites du journal que j’ai tenu durant mes 59 jours sur le plateau de Rosebud. Elles visent à restituer quelques fragments de l’histoire d’une production complexe, riche en péripéties, et proposent donc de celle-ci quelques impressions vraies plutôt qu’une analyse ou une évaluation méthodiques.
Juan-les-Pins
27 mai. Après deux mois de pré-production l’équipe de Rosebud s’est établie à Juan-les-Pins pour une quinzaine de jours de tournage. Preminger a consacré les deux dernières semaines à faire répéter ses cinq « kidnappées » : Isabelle Huppert, Barbara Emerson (remplacée depuis par Brigitte Ariel), Lalla Ward, Kim Cattrall et Debra Berger. Comme au temps de Bonjour Tristesse (et ce ne sera apparemment pas le seul point commun entre ce film et Rosebud), il mise sur des comédiennes jeunes, encore peu connues et inégalement expérimentées. Kim Cattrall, par exemple, tourne là son premier film, Debbie Berger (fille du comédien William Berger) n’a participé qu’à quelques petites productions italiennes ou allemandes et au dernier film de Carné, tandis qu’Isabelle Huppert, Brigitte Ariel et Lalla Ward sont déjà, dans des domaines divers, des professionnelles. Il se pose donc un problème d’homogénéité ; il y a des disparités à atténuer, un ton à trouver. Une lecture rapide du scénario fait apparaître ces premières scènes comme essentielles : elles devront créer un intérêt immédiat pour des personnages qui vont pratiquement (à l’exception d’Huppert) disparaître après le premier tiers du film.
La dernière répétition a lieu dans la cuisine du « Rosebud » et met en présence quatre des héroïnes (Huppert, Ward, Berger, Cattrall). La scène se déroule dans un lieu clos et étroit et, sans être particulièrement complexe, elle exige d’être définie par avance dans ses moindres détails, tant en ce qui concerne le rythme que la coordination, la nature des gestes, le placement des personnages par rapport à la caméra.

Preminger raisonne à la fois en termes logiques (les gens doivent être à tel endroit, tel accessoire en tel lieu, en fonction du déroulement de l’action – en l’occurrence la préparation d’un plat) et plastiques. Il recherche un mouvement naturel, ainsi que l’angle permettant le meilleur raccord possible sur la sortie de Kim Cattrall qui conclura la scène (la caméra reculant alors pour un très court travelling qui l’amène aux confins du décor, décor serré à l’extrême, dont il convient d’exploiter toutes les possibilités). Il n’y a place, durant la répétition, que pour Preminger, ses interprètes et le cadreur, Jimmy Devis. Le directeur de la photo, Denys Coop (caméraman sur Sainte Jeanne et Bonjour tristesse, chef-opérateur de Bunny Lake a disparu) est contraint de rester hors du décor proprement dit, mimant pour lui-même, par-dessus l’épaule de Preminger, la mise en place des lumières.
Ton général : précis, sans tension, avec de nombreuses pointes ironiques d’O.P. Aucune rigidité dans les rapports entre metteur en scène et équipe : le caméraman n’a pas seulement pour fonction de cadrer ou de veiller au respect des marques. Il contribue éventuellement à l’élaboration des plans, fait des suggestions, modifie la place des accessoires, etc.
Annonçant avec des mines gourmandes qu’il va être « terrible », O.P. fait reprendre la scène dans son intégralité à chaque erreur de texte ou de mouvement. À la fin de la répétition, il précise le sens d’une réplique, nuance une intonation et, par des flatteries caractérisées, comiques, rectifie une position ou un mouvement : « Je veux voir votre visage, il est plus beau que votre dos ; dans quelques années, ce sera le contraire, voyez pour ce qui me concerne… » Rapidité, professionnalisme de l’équipe : un simple murmure d’O.P. suffit à remettre les choses en place. Il n’y a aucun temps mort : on répétera deux heures sans s’arrêter, jusqu’à ce qu’il se déclare satisfait. La scène se développe simultanément sous tous ses aspects, acquiert son ton, son « volume » sur tous les plans à la fois : diction, placement des acteurs, de la caméra, fragmentation du décor, emploi des accessoires. Tout prend corps dans un lieu, qui ne peut être que le lieu de l’action. Hors de celui-ci, rien ne pourrait réellement se préparer.
28 mai. Tournage de la scène de la cuisine et de l’arrivée de Patrice (Yves Beneyton) à bord du « Rosebud », où l’accueille Joyce (Kim Cattrall). La scène fait intervenir brièvement le personnage du capitaine du « Rosebud », qu’interprète Gary Bunce, commandant du yacht « Brave Goose » que la production a loué et rebaptisé pour les besoins du film.
C’est autour du mouvement de ce personnage secondaire que la scène va s’organiser après une première prise. Pour gommer l’artifice de l’intrusion du personnage et la trop longue attente qu’elle entraîne, O.P. donne à Gary Bunce une ligne de texte et surtout décide de jouer sur un espace plus serré, une proximité plus grande des participants. La caméra suit Patrice en travelling avant jusqu’à l’intervention du capitaine, puis vient recadrer Patrice et Joyce de plus près au moment où le capitaine retourne à sa cabine. O.P. fait ensuite ajouter un geste à Kim, qui ôtera son chapeau sur l’une de ses premières répliques (« Je viens d’arriver »). À la cinquième prise, il incorpore à la scène une nouvelle silhouette : Frank Woods, un des marins du « Rosebud », qui joue un rôle-clé dans le déclenchement de l’intrigue (c’est grâce à sa complicité intéressée que les terroristes s’emparent du bateau). L’interprète (Patrick Floershein) est hâtivement préparé, son pantalon, trop grand, rajusté avec des épingles. Il devra passer dans le champ, observant Patrice d’un air soupçonneux, « comme s’il s’agissait d’un espion », et continuer sa progression sur le pont.
Dans cette scène relativement courte, la méthode de Preminger consiste donc à élaborer une série d’« événements visuels », une séquence de mouvements, de déplacements, de gestes, s’appelant l’un l’autre par une série d’impulsions complémentaires : entrée de Patrice dans le champ –départ du travelling – arrivée du capitaine – Joyce se tournant vers lui –départ du capitaine – recadrage – geste de Joyce ôtant son chapeau –passage dans le champ de Frank Woods. Tout son effort tend vers une meilleure fluidité dans l’enchaînement de ces données et vers un gommage de l’excédent. Les comédiens sont essentiellement les vecteurs de cette chorégraphie.
Cette scène, qui n’est que de transition, permet cependant de situer le personnage de Joyce, surtout par opposition à Patrice, « gauchiste » sentencieux. Le « rich brats » (petites filles gâtées) dont il la qualifie ainsi que ses copines prépare le dialogue de la cuisine, participe de ces quelques touches introductives sur l’arrière-plan social et familial des cinq filles : toutes, à l’exception d’Helene, sont, en effet, des filles de milliardaires ayant connu une vie facile ; elles sont habituées à tout avoir sans effort, d’où leurs petites rébellions sans conséquence (Sabine contre son grand-père, Margaret contre sa mère, Gertrude contre son père), leur désir d’aventure, qui va être comblé, ironiquement, de la manière la plus inattendue…
L’équipe : son noyau (équipe photo, équipe son, directeur et secrétaire de production, électriciens, machinistes, accessoiristes) est britannique. Chaque pays (France, Allemagne, Israël) fournira le personnel d’appoint tant sur le plan technique qu’administratif. O. P. a amené des États-Unis son fils Erik, scénariste (qui l’avait assisté sur la production de Junie Moon, Skidoo et Des amis comme les miens), son attaché de presse, Bud Rosenthal, qui fonctionne ici comme producteur associé, Jean-Marie Pélissié, cinéaste francais résidant à New York et qui fera fonction de réalisateur de deuxième équipe, et deux « observers » (stagiaires) de son bureau new-yorkais : Ken Kaufman et Tony Gittelson (qui serviront aussi de répétiteurs).
29 mai. Depuis qu’il est devenu producteur indépendant, Preminger a fait participer ses musiciens à l’intégralité du tournage (ce qui explique le recours fréquent à des compositeurs encore jeunes, et dont les exigences financières sont compatibles avec des méthodes qui seraient, sinon, prohibitives). Laurent Petitgirard, qu’il a rencontré sur le plateau d’une émission de Philippe Bouvard et engagé quelques jours plus tard pour écrire la musique de Rosebud, suivra la réalisation à partir d’aujourd’hui. Âgé de 21 ans, il a déjà travaillé sur quelques films français, tout en poursuivant une carrière de compositeur, pianiste et chef d’orchestre. Il n’a pas encore discuté la nature de la partition, envisage un accompagnement « moderne », ample (100 à 200 exécutants), et s’attend à un « conflit d’idées intéressant ». Les plateaux premingeriens sont traditionnellement très ouverts. Rosebud ne faillit pas à la règle et bénéficie d’une « couverture » importante quoique discrète : parallèlement à la venue d’une équipe de la télévision autrichienne, Jean-Marie Pélissié commence le tournage d’un reportage destiné à s’insérer dans un « spécial » Preminger. Depuis le début de la pré-production, un cinéaste new-yorkais, Ted Gershuny (Holy Night, Bloody Night, Les Pulpeuses) suit par ailleurs chaque aspect du tournage, en vue d’une étude qui s’annonce extrêmement fouillée et tiendra à la fois du document et du roman.
1er juin. À la suite d’une altercation relative aux méthodes de travail d’O.P., Yves Beneyton quitte le film, ayant déjà tourné, outre le plan de son arrivée, une scène d’amour avec Brigitte Ariel. Il est remplacé par Georges Beller, qui aura deux jours pour se préparer.
Matinée consacrée au tournage d’un échange entre Margaret et sa mère (qu’interprète Adrienne Corri, une « ancienne » de Bunny Lake redécouverte dans Orange mécanique). Bon exemple de la passion notoire d’O.P. pour la grue, qui entraîne parfois des problèmes techniques épineux. Cette fois, la grue est arrimée au châssis d’un camion. Elle découvre la baie d’Antibes en pano. Apparaît la Rolls de Margaret et sa mère. Le camion part en travelling arrière, la caméra s’abaisse pour recadrer la Rolls qui vient se disposer parallèlement au camion pendant l’échange, puis ressort du champ en accélérant. Outre la difficulté qu’il y a à établir un rapport correct de vitesses entre les deux véhicules, il y a celle de régler l’apparition d’une voiture supplémentaire devant occuper un instant le champ en se plaçant entre le camion et la Rolls. Après six prises infructueuses, O.P. supprime le second véhicule, ce qui ne laisse plus à régler que le « simple » problème du point. Trois prises y suffiront.
Après-midi : arrivée de Claude Dauphin (venu plus tôt que prévu en raison du départ de Beneyton), qui tourne son discours télévisé (lecture du message après l’annonce du kidnapping). Fargeau, son personnage, semble avoir été, au moins partiellement, inspiré par celui d’un « grand » de l’aéronautique française – bien que Bonnecarrère s’en défende. O.P. ne s’attache pas à cette « clé » éventuelle. Ce qui, sans doute, l’intéresse chez Fargeau, c’est cette faille secrète qui l’apparente à nombre de ses personnages antérieurs : Fargeau cherche à dissimuler son identité, pour se protéger, et cette mascarade se retourne contre lui (cf. le mari de Schneider dans Le Cardinal, acculé au suicide par une même volonté de dissimulation ; dans Tempête à Washington, le thème du passé « honteux » de Don Murray et, plus loin, dans Rosebud, en mineur, le personnage d’Else).
3 juin. Retakes de la scène d’amour et de l’arrivée de Patrice. Gary Bunce est un « pro » naturel qui retombe sans effort sur ses marques. Kim, bien qu’elle ait déjà joué la scène de l’arrivée avec Beneyton, est très nerveuse et fait une erreur dès la première prise. Elle dit ses répliques à une vitesse excessive, remue la tête sans raison. O.P. corrige la démarche, « funèbre » selon lui, de Beller et, pour faciliter son texte, y change quelques mots. À la cinquième prise, le mouvement d’ensemble est trouvé, mais Beller butte contre la prononciation de « rich » (dont il fait « reach ») et de Fargeau, qui devient Fargot. Alternant flatterie et harcèlement, menace et ironie, O.P. promet de lui arracher les cheveux un à un. Après deux autres prises, il encourage Kim, se déclare satisfait de Beller. Nouvelle erreur de Kim à la dixième prise. Cinq autres prises loupées (deux pour des raisons techniques, trois pour des erreurs de dialogue). Kim a un « trou » à la seizième et se frappe les tempes, épuisée et au bord des larmes. La dix-septième sera la bonne. Inquiet, Preminger se fait répéter le nombre de prises par la script, Angela Martelli, et constate qu’il n’a obtenu dans aucune d’elles les résultats qu’il escomptait. À Kim (qui ne comprend pas) : « Vous avoisinez les records de Marilyn et de Novak » (réputées toutes deux pour leur fâcheuse prodigalité en cette matière).

4 juin. Préparation de la scène du repas sur le pont du « Rosebud ». La première partie situe les rapports entre Fargeau et sa petite-fille Sabine. Celle-ci lui présente Patrice, très réticent. On enchaîne sur le repas, au cours duquel un conflit éclate entre Patrice et l’industriel. Joyce, Gertrude et Margaret n’interviennent qu’indirectement, les deux premières par des regards inquiets, la troisième par un commentaire dédaigneux sur les « mauvaises manières » de Patrice. Helene, plus proche de Sabine, ne fait rien pour l’aider et coupe même court, avec une certaine malice, à ses tentatives de diversion.
O.P. introduit dans la scène un humour à peu près imperceptible à la lecture du scénario. Son sens de l’affrontement, son goût pour l’escarmouche verbale (Autopsie, Tempête) sont évidents et lui font donner un relief particulier à ce dialogue où s’opposent schématiquement deux représentants ultra-typés du capitaliste et de l’intellectuel militant. L’« explication de texte » qu’il donne ne saurait être plus détaillée, nuançant tous les éléments cachés du dialogue Dauphin-Beller pour transformer celui-ci en une joute serrée. Dauphin ajoute de lui-même une saveur particulière à des répliques insignifiantes, des doubles sens imprévus. Si le tournage de l’après-midi du 1er juin (Sabine et Helene arrivant en vue du « Rosebud », chargées de provisions) décevait par le côté purement mécanique de la direction d’O.P. (il se contentait d’accélérer le mouvement, d’enjoindre à plus d’allant), ici l’approche est d’une grande minutie : on assiste presque à un mot à mot.
Par ailleurs, O.P. commence, pour la première fois, à fragmenter, à se « couvrir ». L’articulation des plans ne correspond pas seulement aux moments de la scène, elle est destinée, de toute évidence, à éviter les trous de mémoire de certains interprètes et à pallier leurs défaillances linguistiques. Depuis quelques jours, O.P. s’est résigné à doubler une partie des acteurs français et tient, dans cette perspective, à bénéficier d’un maximum de « lisibilité ». Pour l’instant, il s’attache à simplifier au maximum le dialogue de Beller qui, aidé par Ken Kaufman, a surmonté le handicap de son impréparation, tout en restant assez rebelle à la syntaxe et la rythmique du texte. Denys Coop, optimiste, souligne que l’accent des comédiens s’améliore de jour en jour. O.P. : « Vous voulez dire que tout sera parfait pour le dernier jour de tournage ? »
5 juin. Première lecture complète du scénario. Trois parties se dégagent, qui correspondent en gros aux lieux de tournage : France, Allemagne, Israël. Dans la première : mise en place de l’intrigue, avec un usage abondant du montage parallèle ; familiarisation avec les personnages des filles. Dans la partie médiane : introduction de l’agent secret, Larry Martin (Robert Mitchum) (1) et intermède germanique, jouant un rôle de leurre (la piste ne mène nulle part). Épilogue israélien : bande dessinée politique avec le personnage de Sioat, sorte de Mabuse d’Arabie. Toute cette dernière partie, qui sonne pour le moins bizarrement, est actuellement en cours de révision et Erik Preminger y travaille quotidiennement, ne faisant que quelques rares apparitions sur le plateau. Pour le moment, le casting de Sioat n’a pas été arrêté. Ingo Premenger a suggéré de recourir à Hitchcock. Idée géniale : Hitch enturbanné invoquant Allah… Après un pareil gag, qui songerait sérieusement à parler des « astuces promotionnelles » d’O.P. ?
(1) Robert Mitchum fut remplacé après quelques jours de tournage par Peter O·Toole. Cf. plus loin.
Dans son état actuel, le script est loin – c’est un euphémisme – de rallier tous les suffrages. Il néglige certaines des idées les plus efficaces du roman de Bonnecarrère et Hemingway et le chantage des terroristes, notamment, y perd de son relief comme de sa vraisemblance. Les méthodes de Martin, qui se situaient dans la perspective d’une certaine littérature droitière, sont très édulcorées, l’aspect « para » du personnage étant occulté au profit d’une ironie sans doute préférable d’un point de vue moral, plus élégante à coup sûr, mais peut-être regrettable dans ce qui s’annonce essentiellement comme un film d’action. L’intrigue prédomine en tout état de cause sur les « à-côté politiques ». L’abondance de fausses pistes et de retournements, et surtout cette annulation finale, ce recommencement à zéro de l’action pourraient renvoyer aux épilogues « sceptiques » d’Autopsie ou de Tempête, mais pourraient aussi bien trahir la souveraine indifférence de Preminger à son matériau, la certitude qu’en fin de compte, c’est à la mise en scène seule que tout se jouera.
10 juin. Première journée de tournage avec Mitchum. La scène se situe vers la fin du film et met en présence Martin, Margaret (dont c’est la dernière apparition), Helene, et un personnage secondaire, Shute, en compagnie duquel le trio va visiter une embarcation d’un modèle hollandais (« Klasen ») identique à celui qui servit au transfert des filles en Corse, après la capture du « Rosebud ». La seconde partie de la scène se déroule sur le quai, avec une brève altercation entre Martin et Helene (qui insiste pour le suivre en Corse et l’aider à retrouver la trace des prisonnières). Bien que l’épisode se situe dans le dernier tiers du film, c’est la première fois que l’on verra en plan général l’ensemble de Port Gallice, lieu de mouillage du « Rosebud » : exemple frappant de l’indifférence de Preminger aux plans « de présentation » qu’il rejette, au grand regret de son opérateur, comme une concession ennuyeuse et finalement inutile.
Au cours de la répétition, Mitchum hésite sur son texte, mais se reprend très vite, donnant le sentiment, même en ces quelques accrocs, d’une maîtrise totale. L’ironie qu’il véhicule sans effort dans ses moindres gestes apporte au personnage une charge supplémentaire qui, à la longue, le fera peut-être « basculer » dans sa vraie dimension.
Après-midi : tournage de deux scènes situées dans la marina de Shute et encadrant la visite au « Klasen ». Dans la première, Margaret et Helene étudient les plans que leur présente Shute et désignent, non sans peine, celui de leur embarcation. Dans la seconde, Helene revient seule, avec un costume, un maquillage et une coiffure différents, prouvant à Martin qu’elle pourra l’accompagner sans être reconnue (Shute, au premier abord, ne l’identifie pas.)
O.P. se soucie d’abord de l’emplacement des accessoires : maquettes sur le bureau, bouées à l’extérieur, sur le balcon, rectifiant leur position, jusqu’à satisfaction. Il place Isabelle Huppert et Lalla Ward à côté de Shute (Mark Burns), tandis que Mitchum reste en retrait, légèrement extérieur à l’action.
Après une heure de préparation, début des répétitions. O.P. souligne les moments-clés de l’intervention de Burns, signalant que son attitude par rapport aux filles devra être strictement objective et impartiale : c’est celle d’un spécialiste qui cherche à connaître la vérité malgré le caractère contradictoire des témoignages qu’il recueille. Lorsqu’il arrive à la conclusion que « seuls les Hollandais utilisent ce modèle », les quatre personnages se lèvent et quittent la marina pour inspecter le « Klasen ». Deux autres répétitions pendant que se poursuit le réglage des éclairages : Burns, cette fois, donnera la conclusion à Mitchum, exprimant sa satisfaction. Preminger veille cependant à ce qu’il n’ignore pas ce dernier, muet au cours de la scène, et qu’il l’« inclue » dans son interprétation. Quant à Helene (Huppert), sur le point de tomber amoureuse de Martin, elle devra se tourner vers lui à deux ou trois reprises, au cours de son intervention.
Après trois prises (la dernière manquée parce que Burns est resté visible dans le champ après sa sortie de la marina), O.P. corrige le rythme, un peu trop rapide, de Lalla Ward. Mitchum propose que Burns se serve de sa règle et la pose sur ses plans avant de sortir : « cela marquera sa familiarité avec le décor. » À la quatrième et dernière prise O.P. précise (pour la première fois, apparemment) que le plan est la conclusion d’une entrevue qui a déjà duré théoriquement une bonne heure. La première réplique, récapitulative, doit donc être dit plus lentement que celles qui suivront.
Sensible changement d’atmosphère vers le milieu de l’après-midi : Mitchum intervient pendant les explications de Preminger et cherche à guider Huppert (sous-entendant qu’elle a besoin de son aide), sans se soucier d’observer la limite assez stricte tracée par O.P. entre travail et plaisanterie. Il multiplie les mimiques comiques, intervient auprès des techniciens harassés par la chaleur, fait de l’équilibre sur la cage de l’escalier. O.P., dont l’enthousiasme est au plus bas, cherche à le ramener à un comportement plus grave : « Ce genre de choses est drôle à vingt ans. » – Mitchum, dans un raccourci percutant : « Otto, dans le temps, j’était juif. J’ai laissé tomber. » Il s’absente alors, et revient avec un certain retard, dans un état apparemment peu propice à améliorer son interprétation. Le tournage se termine dans une atmosphère très tendue, malgré l’effort manifeste d’O.P. pour éviter un affrontement direct. Découragement général et sentiment que le film est maintenant sérieusement compromis.
Corse : Bastia

13 juin. Arrivée des « scouts » (commandos) israéliens, conduits par Saul (rôle tenu par Ted Gershuny). Une fois encore, souci constant d’O.P. d’imprimer une allure rapide et décidée aux scènes d’action. Il est remarquablement secondé par son premier assistant, Wolfgang Glattes, qu’il considère comme l’un des meilleurs de la profession, et qui réussit à être partout à la fois, organisant les mouvements de masses avec économie et autorité. Excellent planificateur, doté d’un sang-froid à toute épreuve, il manque parfois de diplomatie avec certains acteurs et rencontre de ce fait quelques difficultés.
Première apparition de Cliff Gorman (Hamlekh) sur le plateau : très connu aux États-Unis pour son interprétation à la scène du rôle-titre de « Lenny », c’est un acteur « physique » au dialecte et à l’humour typiquement new-yorkais. Son rôle de fonctionnaire zélé des services de sécurité israéliens va l’opposer à Martin dans une sorte de rivalité fraternelle.
14 juin. Seconde et dernière journée de tournage dans le port de Bastia. Très tôt le matin, une équipe réduite (Coop, Jimmy Devis et ses assistants) tourne quelques plans de l’arrivée du paquebot d’où l’on verra ultérieurement débarquer le chef des terroristes, Hacam. Ces plans pourraient servir de générique. Dans la matinée, mise en place laborieuse de la figuration en présence de nombreux journalistes, curieusement invités pour la scène la plus difficile et la plus ennuyeuse tournée à ce jour… Avant la descente d’Hacam, on assiste à la sortie d’une famille d’Américains : père, mère et fils sont habillés de la façon la plus voyante et échangent un dialogue exaspéré qui situe le lieu de l’action. Dans ce qui pourrait bien être une auto-référence ironique à l’ouverture d’Exodus, le fils récite un passage du guide touristique : « Bastia, capitale de la Corse… »
Corse : Île Rousse
17 juin. Premier des onze jours de tournage prévus dans la ferme Salvini, lieu de détention des cinq kidnappées. Atmosphère nouvelle : cet extérieur va être utilisé pendant une période relativement longue et le contact avec ce décor (très dépouillé) se fait plus en profondeur.
Arrivée sur le plateau de Cliff Richardson qui, avec son fils John, supervisera les effets spéciaux. Passionné de mécanique, inventeur de plusieurs procédés (« machine à brouillard » portative, armes spéciales, etc.), il a débuté en 1924, travaillant comme accessoiriste avant de passer au département maquettes d’un des premiers grands studios britanniques. Six ans à la British International, quinze ans aux studios Ealing, quelques années chez Korda… Devenu free-lance, il a collaboré notamment à Exodus, Lawrence d’Arabie, Chacal, Casino Royale et La Vie privée de Sherlock Holmes. Lorsqu’O.P. lui a fait lire le script de Rosebud, il a radicalement modifié la conception originale de la scène de la neutralisation des terroristes, qu’il jugeait techniquement irréaliste et a réécrit en conséquence le texte explicatif de Saul.
Angela Martelli, se basant sur la longueur du script, a minuté le film à 2h40 environ, et O.P. commence dès maintenant à envisager certaines coupes, demandant par exemple à Erik d’abréger le message de Sabine.
24 juin. Répétition, sous la direction de Bob Simmons, du combat Mitchum (Martin) – Amidou (Kirkbane). Cette scène a été révisée plusieurs fois : originellement, Kirkbane, intoxiqué par le gaz que Saul et ses hommes sont parvenus à infiltrer dans la ferme, retourne accidentellement un pistolet contre lui. Dans une autre version, plus réaliste, il retombe sur son arme (une sorte de poinçon d’un métal très résistant qu’on l’avait vu employer auparavant pour liquider Frank Woods et l’équipage du « Rosebud »). Simmons étudie le décor et après avoir confronté les deux comédiens – aussi crédibles physiquement l’un que l’autre, malgré des différences morphologiques évidentes –, propose qu’au terme du corps à corps, Martin torde le bras de Kirkbane après que celui-ci a réussi à s’emparer de son arme. Le coup partira dans le dos de Kirkbane, sans que l’on sache exactement s’il s’agit d’un hasard et qui a appuyé sur la détente. Ayant approuvé la conception de Simmons, O.P. lui laisse toute latitude pour préparer les acteurs.
Fin d’après-midi : Preminger, devant s’absenter pour une cérémonie officielle au cours de laquelle il est fait « citoyen d’honneur d’Île Rousse », fait répéter le plan où Mitchum, les scouts et Hamlekh quittent la ferme de Locci, et laisse à Wolfgang Glattes le soin de la tourner. L’atmosphère, qui s’est progressivement détériorée au cours de la journée – pour les mêmes raisons que le 10 –, vire cette fois au noir. La crise paraît inévitable.
25 juin. La rupture est consommée en quelques minutes, au terme d’une explication discrète, ferme et rapide entre O.P. et Mitchum, qui quitte le film à l’aube de son quatrième jour de tournage. L’équipe plie bagage et repart pour Île Rousse. La matinée est consacrée au tournage d’une scène de raccord devant l’hôtel de ville, le temps de faire venir en catastrophe Sylvain Corthay, qui devait tenir, quelques jours plus tard, le rôle – épisodique – du gendarme qui accueille Helene après sa libération (2). Sur le plateau, O.P. reste d’un calme étonnant, prenant avec sérénité la défection de sa vedette, comme si la soudaine clarification de la situation le soulageait. L’extrême difficulté paraît le rassurer et c’est en souriant qu’il qualifie la situation de « dramatique ». En même temps, son isolement presque tangible au sein d’une équipe qui vaque à ses occupations propres et s’installe sans rupture dans une nouvelle routine, illustre mieux qu’auparavant le rapport profond qu’il entretient avec des collaborateurs auxquels il a fait savoir très vite, avec la plus grande netteté, qui était « à la barre » : c’est peut-être, à cet égard, la journée la plus instructive depuis le début du tournage. Quelques heures plus tard, on apprend que Peter O’Toole (sollicité antérieurement pour un autre rôle) remplacera Mitchum.
(2) Rôle coupé au montage.
30 juin. Premier jour de tournage avec O’Toole, consacré aux retakes des scènes du moulin à huile et des mules tournées par Mitchum (les plans de Port Gallice seront réalisés en fin de tournage). Contraste absolu entre les deux interprètes. Maigreur ascétique d’O’Toole, teint très pâle, comportement plus « cérébral », plus consciemment star. Entre les prises, manque apparent d’intérêt pour le film, désinvolture, plaisanteries avec l’équipe (dont il connaît bien plusieurs membres). Mais aussi, très vite, compréhension instinctive de la conduite à suivre. Si Mitchum poussait l’individualisme jusqu’à adopter un comportement de rebelle, O’Toole, contraint de frayer avec un art qui lui a valu une certaine considération mais ne lui a que rarement apporté le succès, ferait plutôt figure de prince exilé. Ceci accentué par la présence d’un « staff » personnel (maquilleur et doublure) vigilant, soucieux de sa protection.
1er juillet. Ne pouvant prétendre à une performance « physique », O’Toole commence à construire un Martin totalement imprévu. Il tourne aujourd’hui la scène de la libération des captives, l’une des toutes dernières du film. C’est la conclusion d’une action de commando menée conjointement avec Hamlekh et ses « scouts » (rôles tenus par les trois « observers » Ken, Tony et Ami). L’accent mis par O’Toole sur son « Thank God » murmuré, étouffé, lorsqu’il découvre les otages indemnes, éclaire par avance l’interprétation qu’il va donner de Martin. On sent à partir de là comment il va élaborer son personnage, à rebours, à partir de cette fin d’itinéraire. Ce sera probablement une sorte de dandy, grotesquement accoutré (détail inédit et auquel il tient), un peu névrotique, précieux, peut-être secrètement malade, qui ne se résoudra qu’in extremis à employer la violence. Conséquence imprévue de ce changement de perspective : au vu des pantalons trop courts d’O’Toole, le costumier Mike Jarvis a demandé à ne plus figurer au générique…
3 juillet. Depuis l’arrivée d’O’Toole, un dialoguiste anglais a retravaillé son texte, de façon à le rendre plus idiomatique et à lui conférer une légère coloration britannique, sans pour autant en modifier la substance. O’Toole s’attache à introduire un certain humour dans son personnage, le plus souvent avec la complicité de Preminger, qui veille cependant à le freiner lorsqu’il estime ces touches déplacées. Vu aux rushes le combat Amidou-O’Toole : l’action ne paraît crédible que dans les prises caméra à la main. O.P. a fait plusieurs plans de détail qui permettent de masquer la mauvaise coordination physique d’O’Toole et d’aboutir sans doute à une action plus serrée.
Paris

22 juillet. Après dix jours d’interruption forcée, tournage dans la salle de projection de la rue Washington. La scène introduit trois personnages nouveaux : Nikolaos (Raf Vallone), Carter (Peter Lawford) et Donnovan (John V. Lindsay). Le casting de ce dernier représente de la part de Preminger un choix comparable, toutes proportions gardées, à celui du Juge Weaver dans Autopsie d’un meurtre. L’idée de distribuer un homme jouissant d’une certaine notoriété pour tenir ses propres fonctions (ou quasiment) est une constante de son cinéma. On y retrouve ce désir de réalisme qui le caractérise dans le choix des petits rôles, mais il est aisé d’y percevoir aussi une satisfaction d’ordre impérialiste à substituer au masque officiel de ces acteurs occasionnels un autre, propre à s’incorporer à une fiction dont il domine et organise tous les détails. Ancien maire démocrate de New York, Lindsay, qui a joué un rôle de premier plan dans l’histoire récente de la ville, appartient à cette génération de politiciens américains jeunes et brillants qui ne pouvaient voir le jour qu’avec Kennedy ou aussitôt après. Les médias lui ont été extrêmement bénéfiques et, connaissant leur influence, il a participé à de nombreux shows. Il a donc une familiarité totale avec la caméra ; un « charisme » sans affectation qui en fait, sur le plateau du moins, la vedette du jour et lui vaut un traitement de faveur de la part des techniciens. (À noter que ceux-ci hiérarchisent très vite les acteurs, bien plus en fonction de leur comportement que de l’importance de leur rôle, distinguant, par ailleurs, nettement ce qu’ils appellent les « personnalités » (Mitchum) et les « vrais acteurs » (O’Toole) qu’ils traitent avec un respect sensiblement plus grand : toujours cette idée propre aux Anglais que seul l’acteur de composition caméléonien mérite vraiment la considération.)
24-31 juillet. Impossibilité d’assister à plusieurs scènes, l’exiguïté du décor amenant à restreindre l’accès du plateau aux seuls participants utiles, à la demande de Denys Coop. C’est le cas notamment pour les scènes se déroulant dans l’appartement de Nikolaos (tournées chez Anatole Litvak, rue Raynouard) et dans le studio de Patrice. Le retard pris (environ quinze jours) amène un léger changement de rythme qui se reflète parfois dans certains choix de mise en scène (pour pouvoir plus rapidement modifier un cadrage, Preminger demande ainsi que le zoom soit laissé en permanence sur la caméra). Malgré le caractère relativement réduit de l’équipe (en Angleterre ou aux États-Unis, on compterait au moins un tiers de techniciens de plus), les problèmes d’intendance pèsent lourd et les techniciens se plaignent du mauvais fonctionnement de l’hôtel qui sert de Q-G.
Une fois de retour à Paris, on remarque davantage le caractère étonnamment clos, « insulaire » de la production, le peu de contacts que les participants entretiennent avec la réalité ambiante.
Atmosphère maussade : le redémarrage s’est mal fait. Arrivé au milieu du tournage, tentation de faire un bilan provisoire :
Presque tout le monde s’est accordé, dès le départ, pour dire que le film « bougerait » bien, en dépit d’une infrastructure assez flottante. Cela s’est vérifié en bonne partie. Ce qui est physique – et qui participe presque toujours d’une découverte –, l’installation d’un personnage dans le décor (la baie, la cabine de l’équipage avant les meurtres, la progression d’Hacam vers la ferme, le débarquement des filles dans la crique, la montée des terroristes à bord du « Rosebud », le décollage nocturne de l’hélicoptère et le panoramique sur la baie de Juan) est fluide, dense, excitant et nerveux. Dans les passages dialogués, en revanche, sérieux problèmes et pas seulement d’ordre linguistique. Caractère fréquemment arbitraire des données, surabondance de notations bouche-trou dont on voit encore mal la fonction.
Allemagne : Hambourg
4 août. Curieuse correspondance entre le contenu du script et l’atmosphère locale. Toute la portion « germanique » du film est une longue filature manquée (on perd la trace des suspects à la frontière de Berlin-Ouest) qui sert seulement, indirectement, à établir le contact avec Sloat. D’où, par mesure de diversion, une abondance de « trucs » techniques, et surtout de commentaires plus ou moins narquois sur la sophistication des méthodes de surveillance allemandes. Toutes choses que doit véhiculer avec enthousiasme et naïveté le personnage de Schloss (interprété par Klaus Lëwitsch, dont c’est le deuxième film en langue anglaise avec Odessa File). Schloss a la fierté étroite et le zèle du fonctionnaire modèle. Il exhibe à Martin les gadgets, l’appareillage qui ont fait leurs preuves dans son pays et en ont fait un des grands états policiers du monde.
Ce souci d’efficience, on le ressent dans la réalité même, dès l’arrivée. Juan, c’était le règne de la bonne franquette, la Corse, de l’artisanat compensé par des expédients de dernière minute (50 figurants recrutés par le directeur de production au lieu de 200 ; les assistants forcés de rameuter le reste en une heure) et Paris, aux dires de certains, ne valait guère mieux. Ici, prise en charge impeccable à l’aéroport, répartition sans bavures, chacun retrouve dans sa chambre d’hôtel la liste complète de l’équipe avec les coordonnées, un plan détaillé de la ville, une liste des restaurants, etc.
Revers de la médaille : tout ce qui est imprévu fait problème. Un régisseur adjoint qui cite en exemple les méthodes de travail de la télévision locale – où les feuilles de service sont établies pour la semaine entière et portent même des indications sur les éclairages –, se plaint d’avoir été confronté à des situations embarrassantes. On a dû arrondir les angles, par exemple recourir à « certaines influences politiques » pour convaincre un conservateur de musée de mettre son bâtiment à la disposition de la production. Il y a de l’Un, deux, trois dans l’air…
Matinée consacrée à filmer les déplacements de la camionnette de Schloss et Martin entre le musée (salle d’observation) et la « société franco-belge » d’où va sortir un suspect porteur d’un document de propagande édité par Sioat.
Après-midi : le temps pluvieux posant certains problèmes de raccords, on se rabat sur l’intérieur de « rechange » prévu par la feuille de service. Entre les prises, O.P. reçoit quelques journalistes. L’un d’eux : « Ainsi, votre frère a écrit un scénario ? Vous parlez très bien notre langue. » À un autre, mieux informé, qui se dit très déçu par un récent séjour à Vienne et déplore que la ville ait perdu toute « gemütlichkeit » (concept typiquement allemand que « charme » et « douceur hospitalière » ne traduisent qu’en partie), O.P. rétorque que celle-ci n’a guère existé que dans les contes de fées. À Paris, il avouait avoir refusé d’y monter le « Moïse et Aaron » de Schoenberg, car « là-bas, toutes les rues me rappellent des amis morts ». L’allemand lui est pratiquement devenu une langue étrangère (bien qu’il y retrouve dès qu’il le parle l’accent de Vienne, que rien ne peut effacer) et il ne s’est jamais adressé à Glattes autrement qu’en anglais.
7 août. O.P. annonce que les révisions sur Sloat sont maintenant achevées. Le casting se fera sur un acteur plus âgé que prévu.
Il s’affirme très satisfait d’O’Toole, particulièrement de l’humour qu’il ajoute en sourdine au personnage de Martin : « C’est un rôle qui ne peut exister qu’à partir de ce que l’acteur lui apporte de sa propre personnalité. » Dans toutes ces scènes qui ne sont que des intermèdes, des fragments d’actions enchaînées à de courts passages explicatifs, O’Toole joue à fond sur son costume, ses accessoires, notamment un chapeau vert (couleur nationale irlandaise), dont il a fait le fétiche du personnage. Il s’établit ainsi un curieux parallèle entre les rapports d’O’Toole au film – il est venu discrètement, en sauveur et aborde son rôle « du bout des doigts » – et Martin lui-même appelé à entreprendre des actions dont il se passerait volontiers. Sans dire qu’il joue contre le film, il semble évident qu’il cherche à s’y impliquer au minimum, bâtissant à partir de son personnage une série d’idiosyncrasies protectrices (refus de se séparer de son chapeau lorsqu’il visite Fargeau, attitude systématiquement soupçonneuse voire hostile) qui, au fond, le servent lui aussi, en tant qu’interprète, le sauvent par avance. Cela lui laisse une liberté considérable dont il use parfois brillamment, dans des improvisations tout à fait inattendues. Lorsqu’il sort d’un bar où on l’a vu engager un dialogue avec une superbe blonde d’une insoupçonnable féminité, il se tourne vers Schloss et laisse tomber : « C’est un homme », à la stupéfaction de Klaus Löwitsch qui reste bouche bée et manque de s’étouffer.
Allemagne : Berlin
11 août. Malgré le caractère très « éclaté », géographiquement parlant, du film, O.P. s’est peu soucié jusqu’à présent de mettre l’accent sur la localisation de l’action, laissant souvent au dialogue le soin de la préciser. La séquence de Hambourg, par exemple, n’est introduite que par un plan de rue anonyme. En cours d’action, on cadre de loin le Mémorial de Bismarck, emblématique de la ville, sans pour autant s’y arrêter. Pourtant, chaque lieu a sa physionomie propre et chaque décor, avec un minimum de retouches, possède sa marque distinctive, depuis le bureau de Fargeau jusqu’à la ferme corse, en passant par les bars allemands, avec leur mélange particulier de rustique, de pompier et de fonctionnel. L’essentiel du travail du directeur artistique s’est fait aux repérages, et depuis son apport se confond avec celui de l’accessoiriste, ou peu s’en faut, car Preminger tient à respecter le caractère naturel du décor.
Pour Berlin toutefois, O. P. semble souhaiter une identification plus précise des lieux, à partir de quelques repères traditionnels : le Kurfürstendamm, la Kaisersgedächtniskirche (fendue en deux par une bombe au cours de la seconde guerre), le mur. Aujourd’hui, journée entièrement consacrée aux scènes de la « Kobis Pictorial ». Après avoir perdu leur suspect (Mike Jarvis) à Hambourg, Martin et Schloss retrouvent sa trace à Berlin et le filent jusqu’à un labo photo servant de boîte postale à Sloat. Afin d’obtenir la coopération de la gérante, Else (Maria Machado), ils se livrent à une rapide enquête sur celle-ci, et découvrent qu’elle entretient des « relations coupables » avec son employée, une mineure. La boutique, située sur le « Ku-Damm », a été aménagée la veille par le directeur artistique et son équipe qui, sur le point de partir pour Israël, et sans doute désireux de gagner du temps, ont garni exclusivement la vitrine avec du matériel Rolleiflex. O.P. perçoit aussitôt le subterfuge et exige la présence de différentes marques, ce à quoi l’on s’emploie hâtivement pendant la préparation du plan introductif (arrivée de la voiture des deux agents et entrée du suspect à l’intérieur du labo).
Mike Jarvis, qui a cumulé pendant ces derniers jours les fonctions d’acteur et de costumier, a habillé – délibérément selon lui – Maria Machado d’un costume qui désigne aussitôt, de façon criante, la particularité de son personnage : pantalon et veste noirs, chemise blanche, cravate à fleurs. Elle-même préférerait quelque chose de moins conventionnel et de plus surprenant. Au vu du costume, O.P. formule la même observation et demande un accoutrement moins ostentatoire. L’assistante allemande de Jarvis revient avec un pantalon blanc, une blouse rose. On supprime la cravate.
Tournage rapide des plans se déroulant à l’extérieur de la « Kobis » : entrée et sortie de Jarvis puis d’O’Toole et Lowitsch et enfin de Birgit Winslow, assistante de production, qui tient le rôle muet de la complice de Jarvis. Mauvaise coordination des figurants, dont certains se retournent en direction de la caméra au milieu de la prise. Agitation et manifestations d’irritation dans la foule des curieux, contenue tant bien que mal hors champ. De même qu’à l’Île Rousse (scène de l’arrivée de Huppert et O’Toole au « Bar des Amis »), le tournage en extérieurs suscite une curiosité qui tourne rapidement à l’hostilité et à l’exhibitionnisme (mais rien de comparable avec les tournages de productions américaines en Italie, où l’obstruction débouche sur le chantage pur et simple, et où il devient nécessaire de payer des dizaines de « figurants spontanés » pour les faire sortir du champ)…
O.P. oubliant momentanément le nom de son interprète l’appelle à se mettre en place avec un « Fraulein Lesbienne » qui suscite le fou-rire général… Inévitablement, une femme, abusée par le réalisme du décor, et sans voir un instant les projecteurs, entre dans la « boutique » au milieu de la prise pour acheter un appareil photo.
Observant de derrière la vitre de la « Kobis » la scène de son altercation avec Martin et Schloss, il est techniquement impossible d’entendre les directives de Preminger. Mais du coup celles-ci se déchiffrent avec une totale évidence à mesure que la scène progresse, en pantomime, évoluant de prise en prise. Comme ses remarques sur le costume pouvaient le laisser prévoir, Maria Machado démarre sur une interprétation légère, féminine et très vive de son personnage. Mais O.P. corrige, freine ses mouvements de la tête et des mains jusqu’à les bloquer totalement. Il l’amène à faire d’Else une femme aux aguets, traquée. Elle suit ses indications avec docilité et petit à petit (en trois prises seulement) émerge une autre personnalité, dure, au port rigide. Les yeux, au départ très mobiles, deviennent fixes. L’actrice ressort, disant avoir l’impression de « soulever des tonnes », regrettant de n’avoir pu faire passer une certaine désinvolture : « Ce n’est pas ainsi que se comportent les lesbiennes que j’ai pu rencontrer (elle cite une comédienne célèbre), mais ce n’est pas à moi d’expliquer ça ».
Le soir au Kempinski, après les rushes, réunion de l’équipe. Le départ pour Israël est prévu pour le 14 et Preminger souhaite informer les participants des risques qu’entraîne la situation locale (les rumeurs concernant une reprise des hostilités se sont multipliées au cours des deux ou trois semaines précédentes) : « Si vous avez un doute quelconque, je ne vous en voudrais pas de vous retirer. Donnez-moi votre réponse demain si vous le voulez. Je ne peux vous offrir aucune garantie. Si une guerre devait éclater sous peu, il me paraît peu probable que nous puissions franchir la frontière d’ici là. Les consignes de sécurité sont extrêmement strictes, et vous risquez donc moins d’être victime d’une bombe qu’à Londres ou Dublin. Il est probable que le gouvernement israélien cherche seulement à obtenir de l’aide, mais, encore une fois, je ne peux vous offrir aucune garantie. » Tout le monde accepte de poursuivre le travail, à l’exception d’un technicien de nationalité israélienne, exilé depuis plusieurs années en Angleterre, et qui avait laissé entendre qu’il risquait certaines difficultés avec les autorités militaires en cas de retour.
12 août. En fait, le problème qui se posait en filigrane, et que personne n’a osé aborder directement, était celui de l’attribution d’une prime spéciale de risque. La situation de l’emploi dans le cinéma anglais ne permet pas aux techniciens de négocier sur un terrain très solide, même s’ils sont conscients des difficultés que leur défection entraînerait pour la production. Ceux qui sont affiliés à un syndicat (la majorité), comme les quelques indépendants, sont ici logés à la même enseigne. Tous sont repartis frustrés. Après-midi : tournage devant un des « checkpoints » de Berlin. No man’s land et atmosphère de fin du monde : la grisaille de l’est commence déjà ici (mais dans bien d’autres endroits de Berlin, il est impossible de faire la distinction des zones). Chacun a amené son appareil photo et pose à tour de rôle avec le mur pour arrière-plan. Dans un angle du « décor », guérite de soldat, panneau portant l’inscription classique en quatre langues informant que « vous sortez du secteur américain ». Dans ces lieux, l’ouest avec son luxe ostentatoire, apparaît comme l’imposture majeure d’une ville qui n’en finit pas de mourir.
18 août. Depuis le tournage d’Exodus, et surtout depuis 68, le cinéma israélien qui a connu un essor important, s’est largement ouvert à la co-production (États-Unis : L’Ombre d’un géant, Judith, Jésus Christ Superstar, feuilleton QB VII ; Italie, Allemagne, France, etc.). La majeure partie du personnel local de Rosebud a donc une solide expérience de la production étrangère et certains travaillent même exclusivement dans ce cadre.
Après-midi : tournage au village arabe de Deir El Asad, situé à flanc de montagne, à quelques kilomètres de Zfat et sous occupation depuis 48. L’équipe, placée sous la protection de gardes armés, déjeune dans la maison, encore inachevée du chef du village (la seule à posséder la télévision). Entre les maisons de forme cubique, aux murs de torchis recouverts de chaux, un chemin escarpé bordé par un tuyau d’eau rouillé, crevé par endroits. Partout sur les toits, des grappes de gosses hurlant, courant en tout sens, en proie à une agitation frénétique. Contraste incroyable, presque obscène, entre la pauvreté des lieux et la sophistication technique, le déploiement matériel exigés par le tournage. Intrusion incongrue d’une modernité qui jure avec le paysage, le costume, l’odeur, le parler : elle est déjà sensible dès que l’on sort de l’hôtel, ici, elle devient presque intolérable.
O’Toole arrive, déguisé et maquillé à la manière de Patrice après son passage à tabac. Effet de ressemblance saisissant grâce au travail de Paul Rabiger (déjà noté à Paris le curieux malaise que produisait le visage « tuméfié » de Beller sur l’assistance, qui ne lui parlait plus qu’à mi-voix, comme à un grand malade).
Dans cette courte scène, « Patrice » reçoit d’un vieux villageois une carte lui permettant de rallier le point où deux émissaires de Sloat le rejoindront. O.P. donne l’ordre de salir légèrement les volets, trop neufs, des quelques maisons visibles dans le champ. Lorsque l’action démarre, nous sommes déjà à l’intérieur du village et il s’agit donc d’indiquer de la façon la plus concise sa position par rapport à la montagne. O.P. décide de faire une plongée sur la voiture de « Patrice », suivie d’un pano-travelling pendant sa montée et de finir en contreplongée avec le village et les montagnes en arrière-plan. Les ordres fusent de partout, en arabe, en hébreu et en anglais, dans une agitation et une chaleur croissantes. Un silence relatif se fait. Un vieil Arabe vêtu d’une djellaba blanche est placé au croisement des chemins. Presque sénile, il saisit assez mal les consignes qui lui sont lancées, moitié en arabe, moitié en anglais. Lorsque Preminger lui dit « Go ! », il reste planté sur place. Ayant compris qu’il devait tendre l’enveloppe contenant la carte à O’Toole, il exécute correctement son geste, mais reste dans le champ au lieu de repartir. Tout s’arrange après deux autres prises, et le village retrouve son atmosphère normale tandis que l’équipe rembarque le matériel au milieu des glapissements des enfants et des bêlements de chèvres affolées…
19 août (nuit). Tournage sur le terrain d’aviation de Bezet, à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Au cours du repas, échos lointains de tirs. Derrière les collines, des projecteurs sillonnent le ciel qui est parcouru à intervalles réguliers par les lueurs rouges des balles traçantes : chaque nuit, on tire, de façon quasi routinière, en direction du Liban. Encore une fois, le tournage se fait sous la protection de gardes.
La séquence va se dérouler en quatre temps : 1) « Patrice » (O’Toole) arrive en voiture au point de rendez-vous, enfile une cagoule, éteint le plafonnier. Arrivée des deux émissaires qui lui demandent de se dévêtir et le fouillent. 2) Décollage nocturne de l’appareil amenant le trio au camp de Sloat. 3) Plan à l’intérieur de l’avion. O’Toole déglutissant pour compenser le changement de pression (détail qui servira ultérieurement). 4) Atterrissage à l’aube. « Patrice » mené en jeep au camp. Pour des raisons pratiques, ce dernier fragment a été réalisé vers 18h au soleil couchant, et le premier sera tourné en fin de nuit.
Cliff Richardson est sur le plateau pour régler l’allumage des feux de signal au moment du décollage. Il demande que le moteur soit déjà en route au moment du déclenchement. 23 heures : seuls deux petits projecteurs éclairent l’avion. Les hommes de Sloat poussent O’Toole, les yeux bandés, à l’intérieur de l’appareil. L’un d’eux revient vers la caméra, allume les feux. Une fumée très dense s’élève, masquant presque entièrement l’appareil. Après avoir effectué un large virage, l’avion revient vers la caméra. O.P. exige le silence pour permettre à Robin, l’ingénieur du son, d’enregistrer l’atterrissage. L’appareil se pose assez brutalement, à environ 800 mètres de distance. Silence absolu, troublé seulement par le cri-cri des grillons tandis que le grondement du moteur, d’abord très lointain, s’amplifie lentement. L’appareil vient s’arrêter à quelques mètres de la caméra. O’Toole descend et annonce, ravi : « Nous avons été repérés, un projecteur nous a suivis tout du long. »
O.P. décide alors d’inverser la direction du décollage pour éviter le vent. On tournera cette fois à deux caméras, l’une opérée par Denys Coop et installée en bordure de piste, l’autre par Jim Devis, prenant l’appareil en contreplongée et le suivant en panoramique vertical (aux rushes, un des plans d’action les plus réussis).
L’équipe se déplace ensuite en masse vers le second extérieur (premier segment de la séquence), situé à quelques kilomètres. Longue file de camions et de fourgonnettes dans la nuit. O.P. proteste contre leur installation abusive, en début de soirée, alors que l’angle de prise de vues n’avait pas encore été arrêté. Wolfgang Glattes souligne la mauvaise organisation générale (exemple : le traiteur, qui bénéficie de six auxiliaires, est loin d’obtenir les résultats qu’Henriette, notre cuisinière, obtenait en Corse avec moitié moins de personnel. Il a eu l’imprudence de nous dire sa devise, en tout état de cause sibylline : « La plus belle fille du monde ne peut vous donner que ce qu’elle a… mais elle peut aussi vous offrir sa sœur », de sorte que les plus cyniques, après deux ou trois repas douteux, commencèrent à réclamer sa sœur…)
Répétition : la voiture de « Patrice » emprunte un chemin de traverse et s’arrête à 200 mètres de la route. Problèmes techniques dès le départ : le véhicule n’arrive pas à braquer (ce que l’on avait déjà constaté la veille au village). O.P. : « Pouvez-vous m’expliquer pourquoi nous perdons tant d’argent à faire ce plan ? Nous mettons toute notre fierté à obtenir un rabais de 20% chez Hertz, et perdons ensuite la moitié de la nuit »… Aussitôt, dix personnes se pressent autour de la voiture qui, miraculeusement, accepte de fonctionner…
3h30 : mise en place du dernier plan : « Patrice » ayant arrêté la voiture, attend l’arrivée des émissaires de Sloat dont l’apparition est signalée par la lueur de deux lampes de poche trouant la nuit après quelques secondes d’obscurité totale. O.P. exige un silence absolu pour la scène. Il s’irrite lorsqu’il ne l’obtient pas, puis, pour la première fois, se retourne pour expliquer, avec une grande candeur, ses colères : « J’explose toujours au mauvais moment et j’engueule des gens qui ne le méritent pas. C’est l’histoire de ma vie… Mais tout se tient dans un film. Ainsi, cette voiture : il était clair qu’elle devait être remplacée aussitôt. Elle ne l’a pas été, et maintenant nous en subissons les conséquences. Tous ces problèmes n’ont rien à voir avec la création et pourtant… » Les torches, branchées sur des accus, commencent à dégager de la fumée sous l’effet de la chaleur, tandis qu’O’Toole chantonne « I’m a strolling vagabond » et commence à se dévêtir, le dos tourné à la caméra. Angela, la script, suit la scène avec une grande dignité, bien qu’O.P. exceptionnellement, l’ait dispensée d’être présente. Discussion équivoque et très technique après la première prise, O.P. croyant avoir aperçu « quelque chose de blanc » –un morceau de ruban adhésif ? – entre les jambes d’O’Toole. Angela donne son avis sur un ton clinique et détaché, avec ce chic parfait qui a fait d’elle la favorite de l’équipe…
Ton particulier des scènes de nuit : depuis le début du film elles tranchent sur le reste du tournage. La proximité, l’intimité entre l’acteur et la caméra se fait plus grande (comme le faisait remarquer Isabelle Huppert), les distances prennent plus de relief, les attentes sont plus longues, chargées de plus d’incertitude. On parle moins parce que les voix portent davantage et qu’il faut économiser ses forces. Ceci explique aussi que les échanges s’orientent plus facilement vers la réminiscence (ainsi, cette nuit, Preminger a quelques mots très chaleureux sur Leon Shamroy, qui fut avec Arthur C. Miller, son opérateur favori, et dont il garde le souvenir d’un homme qui s’engageait totalement aux côtés du réalisateur, avec une exceptionnelle générosité).

Israël : Jérusalem
26 août. Premier des trois jours de tournage dans le camp de Sloat. Le décor, choisi au cours des seconds repérages, est une caverne située à trois kilomètres de Bat Guvrin. Taillée dans le calcaire, elle présente une déclivité importante interdisant tout recours au travelling. L’entrée de « Patrice » guidé par les hommes de Sloat sera donc fragmentée en : a) un panoramique droite-gauche ; b) une contreplongée, prise de la partie inférieure de la caverne. Cette fraction du décor, formant une arène d’une quinzaine de mètres de diamètre abrite le quartier-général de Sloat et l’on y verra quelques-uns de ses hommes travailler devant une presse, classer des documents, etc. Un rideau masque l’entrée des « appartements » de Sioat décorés dans un style oriental.
O.P. examine successivement l’angle d’arrivée de la jeep qui amènera O’Toole et son escorte, puis les costumes des figurants, qui sont un mixte de vêtements civils et militaires. Le directeur artistique qui a passé les deux ou trois derniers jours dans le décor, a ajouté de sa propre initiative une cloison séparant le quartier de Sloat du reste du décor. O.P. proteste, mais décide en fin de compte de la laisser. Il fait déplacer la presse et les rayonnages de manière à ce qu’ils figurent dans le champ dès le second plan de la scène. Il choisit ensuite un jeune Arabe (?) pour tenir le rôle du lieutenant de Sloat (qui devra se donner la mort sous les yeux de Martin) et demande à Cliff Richardson de prévoir un dispositif permettant de filmer le suicide de face. Richardson suggère une capsule de plastique emplie de sang artificiel et munie d’un détonateur miniature isolé par une plaque de métal. L’ensemble sera dissimulé dans le turban de l’acteur et actionné par Richardson lui-même pour un meilleur synchronisme.
Tandis que Michael Seymour et son groupe commencent à déménager la presse, Preminger examine le décor de Sloat, puis remonte vers le haut de la caverne. Déplorant qu’on ne puisse d’emblée en voir le sommet à l’arrivée de Martin, il décide d’ouvrir le pano par un zoom avant (sur l’entrée de Martin) et de conclure le plan par un zoom arrière. Coop objecte qu’il serait dommage de sacrifier le sentiment d’ampleur dans le seul but de montrer la partie inférieure du décor (le camp). Après quelques instants, O.P. décide de tourner trois versions différentes du plan (bien qu’il semble déjà fixé) : 35,40 et zoom.
Mike Jarvis amène cinq Arabes costumés et O.P. reprend l’examen des figurants. Il demande à l’un d’eux s’il est un « vrai » Arabe. L’homme sourit, fait un signe de dénégation (tous, à une exception près, sont israéliens, mais Preminger s’amuse, depuis le début, à souligner les ressemblances physiques entre Juifs et Arabes, feignant la plus grande confusion lorsqu’on le détrompe sur l’identité de tel ou tel interprète).
Tout le monde redescend pour examiner la partie inférieure du décor. À l’arrivée du directeur de production, Yoram Ben Ami, quelqu’un oriente perversement la conversation sur le choix de cette caverne. Confirmant certaines rumeurs, Ben Ami reconnaît que celle-ci a déjà servi, au moins en partie, pour le tournage de Jésus Christ Superstar. O.P. : « Pourquoi ne me l’avez-vous pas dit ? Vous m’avez annoncé que vous aviez fait une découverte extraordinaire… Enfin, peu importe… » Embarras manifeste de Ben Ami (qui n’est guère ménagé depuis le début du tournage, le consensus général étant que son équipe consacre plus de temps à bavarder qu’à travailler).
Arrivée de Richard Attenborough (Sloat). Cet homme, d’une affabilité extrême, d’une totale discrétion, s’étonne doucement, sans y insister, qu’on lui ait envoyé il y a deux jours un scénario entièrement réécrit avec plusieurs répliques en arabe…
Après-midi : tournage de la contreplongée sur l’arrivée d’O’Toole. Suicide du jeune Arabe : difficultés avec ce dernier qui décompose maladroitement les moments successifs de la scène, et reste figé. O.P. lui donne des consignes que l’assistant israélien, Nissim Levy, retraduit à mi-voix. Il se déclare satisfait et demande à Richardson s’il y avait assez de sang. Ce dernier, qui a parfois des difficultés à entendre, lui retourne la question. Vexé qu’O.P. lui ait reproché de parler et ait menacé de le « dénoncer » à son fils, il conclut sotto voce, à l’intention de l’équipe : « Une goutte de plus, et ça devient du Peckinpah ».
Fin d’après-midi : tournage de l’entrevue Sloat-Martin. Preminger fait, pour la première fois, une remarque à voix haute à O’Toole (habituellement, ce sont quelques mots prononcés à l’oreille, à l’écart, et agrémentés d’une plaisanterie). Il lui demande de mettre plus d’humour et de vitesse dans son texte (qu’il a jusqu’alors débité avec une grande monotonie). O’Toole, piqué au vif : « J’en ai assez de toute cette histoire ». O.P. : « Vous devriez être plus léger, et vous moquer de lui. » O’Toole fait une seconde prise, plus vivante, plus rapide. O.P. : « C’est bien, très bien. » O’Toole le remercie, mais reste sur la défensive.
France : Juan-les Pins
4 septembre. Dernier jour de tournage dans une atmosphère qui ressemble fort à celle d’une classe à la veille des grandes vacances. Retrouvailles bruyantes avec les techniciens français rappelés pour la journée. Arrivée tardive de Mike Jarvis, qui s’est réveillé quelques heures après le départ de l’équipe, et a réussi à obtenir son transfert sur Zurich et de là a pu louer une voiture avec un chauffeur. Retakes des plans du « Klasen » et de la marina avec Lalla Ward, Mark Burns et Isabelle Huppert (qui s’apprête à tourner Dupont Lajoie). O.P. ajoute un plan-gag qui n’était pas prévu dans le premier script : on y verra Martin décrocher le téléphone après l’annonce du détournement d’avion consécutif à la capture de Sloat. Mais cette fois, il refuse de partir en mission, raccroche et s’éloigne en direction du port.
18h10. 377ème « ardoise » de Rosebud. Le comptable, David White, fait signer les derniers chèques de la production. Après sept prises, Preminger félicite O’Toole, qui court vers le port, faisant des bonds en l’air.
Le soir, « party » à l’Eden Roc. Promesses traditionnelles de rester en contact. Mais chacun est déjà ailleurs…
Post-scriptum
En assistant au tournage d’un film, on voit progressivement la mise en scène concrète se doubler d’une autre, plus large, qui l’enveloppe et lui assure un curieux écho. La manière même dont un plan se structure et, secondairement, dont le plateau s’organise, traduisent et reflètent l’ouverture du décor ou les limitations qu’il impose au metteur en scène. Dans les meilleurs cas, l’atmosphère du plan sera l’exacte résultante de cette autre « mise en scène ».
Petit à petit, on apprend à voir dans le décor ambiant le lieu naturel du film, illusion facilitée par le caractère nettement impérialiste de la prise de possession par l’équipe de chaque lieu de tournage. À Berlin, le Kurfürstendamm, sitôt le tournage fini, paraissait aussi vide que peut l’être un théâtre au soir de la dernière représentation. Le tournage « vampirise » et absorbe toute la réalité, et ceci s’étend à ceux qui vont, plus ou moins longuement, habiter le film. Venus parfois de fort loin pour tourner une scène unique, ils nous livrent davantage sur eux-mêmes qu’un simple aperçu de leur talent : une part de leur personne. Nous percevons parfois des hésitations inexplicables (ou trop facilement explicables), des regards absents ou crispés, et devenons d’un coup les témoins involontaires d’inquiétudes ou de déchéances dont nous préférerions ne rien savoir. Le plateau peut être parfois un lieu extraordinairement solitaire.
Mais de toutes les impressions multiples et contrastées que l’on peut retirer d’un tel tournage, la plus forte et la plus évidente, sans conteste, est que Preminger se situe réellement au centre même de ses films, qu’il en contrôle tous les aspects, de la conception à la promotion, en passant par l’écriture, le casting, le travail de l’opérateur, la musique, le doublage, le montage.
L’appellation « un film de… » précédant au générique le nom des autres collaborateurs de Preminger a pu sembler orgueilleuse. Elle ne fait cependant que sanctionner une situation de fait, un rapport de forces réel. Elle est à la mesure exacte de l’intervention de Preminger dans la genèse et le développement de ses films, quel qu’en soit le degré de réussite.
On retire aussi de cette expérience le sentiment que Preminger, lorsqu’il parle de lui-même, expose le plus souvent, avec franchise, des attitudes qui sont réellement et profondément les siennes. Le processus, pour une large part inconscient, par lequel ses films se lient les uns aux autres et s’engendrent, ne l’intéresse pas. Il n’y a aucune coquetterie dans cette indifférence : son travail est entièrement orienté vers le concret ; lui-même est avant tout intéressé, fasciné par le réel, peut-être avant tout par la nouveauté comme l’avait remarqué Dalton Trumbo. Cette disposition explique en partie qu’il ait pu, sans solution de continuité, s’intéresser si longtemps à des personnages chez qui prédominait la part « nocturne », puis, à partir du milieu des années 1950, se consacrer à un cinéma où le poids de l’action, de la volonté l’emportaient de façon si éclatante : ces deux virtualités furent sans doute toujours liées en lui, mais il n’a cessé de soumettre la première à la seconde. Redoutablement extraverti, il est, sur le plateau, en parfaite harmonie avec lui-même, et ne dissimule à aucun instant ses satisfactions ou ses irritations, sans songer que tous ne sont pas également prêts à accueillir ses remarques dans les mêmes dispositions d’esprit.
Le tournage devient un exercice de pouvoir, qui est indifféremment pouvoir sur la matière visuelle, définition et organisation d’un espace, et pouvoir sur les personnages de chair qui s’y meuvent. Durant la préparation du plan et la mise en place, Preminger se réfère à peine au scénario, dont il néglige souvent le contenu littéral (une phrase revient dans sa bouche comme un leitmotiv tandis qu’il met en place les acteurs : « quelle que soit votre réplique… ») pour dégager avant tout l’énergie motrice dont la scène est porteuse. Effectuant une démarche synthétique, il ne cherche pas pour autant à allonger la durée des plans (il y a assez peu de plans séquences dans son œuvre, contrairement à ce que l’on a dit), mais veille à en orchestrer les moments (de telle manière qu’ils s’appellent l’un l’autre avec une totale nécessité interne et forment un tout indissociable. D’où sa haine de la variété gratuite, son refus de multiplier les angles (il ne se « couvre » qu’exceptionnellement), sa préférence constante pour la grue, qui rend sensible la continuité spatiale et permet successivement et sans rupture de créer le mouvement, d’isoler et en fin de compte de rassembler les fragments de la scène en une unité dynamique.
Pendant l’intervention de l’équipe, il reste le plus souvent présent sur le plateau, circulant entre les techniciens, veillant à faire régner discipline et silence. Très conscient des risques de déperdition d’énergie et de dispersion, il s’attache à maintenir un rythme de travail qui, sans être dur, exclut tout relâchement.
Le déroulement du tournage proprement dit, varie trop de scène en scène pour pouvoir être globalement décrit ici. Il apporte généralement peu de surprises sur le plan technique : les mouvements, positions et cadrages ont été définis avec une précision qui élimine tout malentendu, et les repentirs de dernière minute sont exceptionnels chez Preminger. La moyenne des prises se situe entre cinq et six et O.P. en fait rarement tirer plus de deux.
À ce stade, l’essentiel du travail porte donc sur l’acteur, avec des nuances considérables dues à l’âge, à l’expérience, à la souplesse et à l’inventivité des comédiens. En règle générale, Preminger laisse l’initiative première à l’interprète, mais le corrige immédiatement, quoique fragmentairement pour conserver une certaine spontanéité à la scène. Les deux ou trois premières prises sont donc fréquemment un prolongement des répétitions et occasionnent des tâtonnements et corrections successifs.
Il apparaît très vite que Preminger souhaite, contradictoirement, voir l’acteur à la fois « nu » et préparé, totalement au fait de son rôle, mais prêt à recevoir, souvent sans droit de réponse, les directives qu’il va lui donner. C’est l’aspect le plus frappant de sa direction, et celui auquel les jeunes comédiens réagissent avec le maximum de vigueur. Mais il importe de souligner que Preminger adopte une conduite sensiblement différente selon qu’il s’adresse à un professionnel chevronné ou à un débutant, manifestant parfois à l’égard de ces derniers des exigences qui vont jusqu’à la dureté, tandis que sa complicité avec les premiers est le plus souvent immédiate. Cette différence d’attitudes recouvre aussi une différence de rapports culturels, un commerce différent avec le langage. Des hommes comme Peter O’Toole ou Claude Dauphin (pour en rester à Rosebud) possèdent un « fond » comparable au sien. Ils sont comme lui attachés au mot et à l’humour, cet humour qui constitue la dominante profonde du tempérament de Preminger et qui, lorsqu’il ne rapproche pas immédiatement ses collaborateurs de lui, les éloigne de manière irréversible.
L’équipe de Rosebud mériterait à elle seule une étude. Véritable tour de Babel ambulante (on y parla l’anglais, le français, l’allemand, l’hébreu et l’arabe), elle constitua un extraordinaire mélange d’individualités, très vite différenciables, d’origines, de modes de comportements distincts qui surent se concilier. Mais sitôt le travail fini, les particularismes reprenaient leurs droits. Aux repas et lors des sorties, l’équipe se scindait immanquablement en fonction des spécialités : l’ingénieur et le preneur de son, l’équipe photo, les machinistes et les électriciens formaient autant de corporations distinctes et faisaient bloc chacun de leur côté.
Cette hyper spécialisation peut paraître excessive, voire absurde (on appelait l’accessoiriste pour déplacer une chaise de cinquante centimètres et le coiffeur devait être présent à trois heures du matin pour rajuster un bandeau), mais elle facilite à coup sûr le professionnalisme. Le sens de l’initiative diminue en proportion inverse : l’apathie, chez ceux qui n’étaient pas requis plus de quelques minutes par jour (coiffeur, photographe de plateau, maquilleur) était de règle. Seuls le directeur de la photo, le caméraman, le premier assistant, la script et l’ingénieur du son participèrent directement à la création du film. Pour les autres, la tâche impliquait avant tout l’écoute d’ordres répercutés par un supérieur qui jouait aussi un rôle de « tampon » en cas de mauvaise exécution.
À l’intérieur de cette production où les responsabilités demeurèrent nettement séparées, les « observers » furent les seuls à circuler de poste en poste, travaillant aussi bien au bureau qu’avec les acteurs, aidant à transporter le matériel, secondant les assistants, doublant tel ou tel comédien, etc. Véritables « polyvalents » du film, ils en furent aussi les premiers juges et peut-être les principaux bénéficiaires (l’un d’eux est devenu lecteur dans une grande chaîne de télévision new-yorkaise). Preminger a entretenu avec eux un rapport paternel et autoritaire, fondé sur une extraordinaire et spectaculaire alternance de sollicitude et de férocité. La variabilité de ses attitudes à l’égard de la plupart de ses collaborateurs, à l’exception des plus proches, se manifestait là avec un maximum de relief.
Il y a chez Preminger une théâtralité naturelle, une manière de concevoir le monde comme sa scène, qui s’exprime constamment, et de bien des façons, dans le commandement comme dans l’humour. Il jauge très vite le comportement de ceux qui l’entourent. Il exige d’eux une disponibilité permanente, conforme à ses critères, déteste les interventions déplacées, mais se montre très tolérant lorsqu’il perçoit un effort réel. À cet égard, certains témoignages paraissent, rétrospectivement, incomplets, négligeant d’évoquer les compliments pour ne retenir que la réprimande, difficile il est vrai à oublier. Preminger compte sur la rapidité de ses interprètes et estime inutile de les mettre dans l’ambiance. Mais il convient, encore une fois, de nuancer : certaines des répétitions, très détaillées, se sont déroulées dans la meilleure atmosphère, ont préparé le terrain avec un maximum de précision mais n’ont pu cependant éviter les défaillances de dernière minute. L’acteur arrivait sur le plateau avec certaines dispositions, mais le film mobilisait ses participants de telle manière qu’un travail « pédagogique » était véritablement impossible et l’espoir de rattraper des insuffisances fondamentales parfaitement illusoire. On pourrait citer certains exemples d’une direction précise, concrète, vivante et dramatisée à souhait de Preminger se convertissant à l’écran en une plate et peu convaincante interprétation et, sans aller jusqu’aux extrêmes relater maints exemples de distorsion entre ce que l’acteur pouvait réellement donner et les directives qu’il reçut. Parfois l’acteur refusait malgré lui de faire passer ce qu’il pouvait livrer ; son effort sincère pour rejoindre le modèle proposé n’aboutissait alors qu’à une caricature : il y avait un choix à faire, dans l’instant, entre l’unité du film et le bien-être du comédien, choix qui ne pouvait être, dans un tel cadre, que le fait du metteur en scène…
Il est difficile de savoir à quel point le tournage de Rosebud reflète celui des autres films de Preminger. À en juger en particulier par la masse d’incidents mineurs ou majeurs dont il a été le théâtre, il y a, au contraire, fort à parier qu’il constitue une exception à l’intérieur de sa carrière.
L’extrême faiblesse du scénario, qu’il est difficile de passer sous silence, fait elle aussi, exception, et peut seulement se comprendre à partir de l’illusion que 1’« intérêt humain » de l’histoire, son caractère d’actualité, sa charge polémique, tempérés par l’humour du personnage principal, autant que la variété des lieux, l’abondance des rebondissements, le mouvement de l’intrigue suffiraient à entraîner la conviction et l’intérêt.
Tout ne fut, effectivement, que déplacements, personnages surgissant sans épaisseur ni arrière-plan, disparaissant sans laisser de trace durable. Une étrange fixation sur des détails triviaux et des gadgets engorgea progressivement le film sans que l’on eut pris soin de s’assurer ses arrières (deux ou trois scènes supplémentaires entre les filles, par exemple, eussent assuré une réalité à la partie « intimiste » de l’œuvre). Certains de ces manques apparurent très tôt en cours de tournage, d’autres seulement après le montage final (qui en masqua certains mais en révéla inévitablement d’autres, notamment par un effort de resserrement qui accentua encore la nudité de la trame).
La mise en scène d’un film n’est pas seulement la concrétisation d’une vision théorique, mais un ensemble de directions, données ou négligées, comprises ou non, et, souvent, tout s’y joue au jour le jour. Comme bien d’autres films sans doute, Rosebud est la résultante d’une multitude d’actions parcellaires, de minuscules détails pratiques à régler. Cet émiettement inévitable interdit toute refonte et, il était clair, au bout de deux à trois semaines, que le film, animé de son mouvement propre, ne pouvait qu’accuser, à mesure, ses manques constitutifs et que l’insuffisance de son script allait progressivement l’affaiblir sans que le travail minutieux et énergique de Preminger pour lui donner corps, jour après jour, puisse jamais réellement aboutir.
Il y a là une manière d’enseignement à rebours sur les plus grands films de Preminger, œuvres de bâtisseur édifiées sur des charpentes d’une solidité à toute épreuve, permettant une multiplication à l’infini des points de vue, des effets et des approches. Tout ceci demanderait maintenant à être revu dans une perspective plus large (en tenant compte en particulier du désir de l’auteur de renouer avec la production internationale après le succès intimiste Such Good Friends) et dépasserait le cadre du simple et direct témoignage que nous avons cherché à livrer ici.