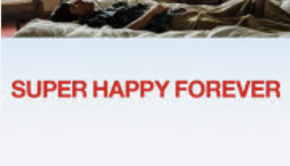Trois mille ans à t’attendre de George Miller
Trois mille ans à t’attendre confirme une fois encore que George Miller est insaisissable et que sa filmographie est résolument tendue vers la surprise. Jamais contenté de ses succès, il offre avec cette adaptation d’une nouvelle d’A. S. Byatt, Le Djinn dans l’œil du rossignol, un nouveau film dont l’originalité risque de déstabiliser certains. À Istanbul, Alithea (Tilda Swinton), une experte dans les composantes du récit et de ses mécanismes ayant perdu la joie de vivre, rencontre un génie (Idris Elba). Comme le veut la tradition orientale, ce dernier lui offre la possibilité de réaliser trois souhaits. Afin de prouver à son interlocutrice qu’il dit vrai, l’être merveilleux lui raconte son histoire rocambolesque se déroulant pendant trois mille années.
Ceux qui se sont penchés sur le grand cinéaste verront ce qui a pu le passionner dans cette histoire : son intérêt pour les travaux des mythologues Joseph Campbell et James George Frazer est avéré. À l’image de Nymphomaniac, qui faisait de la sexualité le carburant d’une multitude de récits narrés dans une chambre à coucher, le film exploite l’imaginaire oriental à travers une succession d’aventures extraordinaires, façon Les 1001 nuits, contées depuis la suite d’un hôtel. Ces deux films narrent une longue odyssée remémorative et cosmogonique à partir d’un intérieur banal. Avec ce film de George Miller, les termes « originalité » et « imagination » retrouvent leurs lettres de noblesse dans cette suite de péripéties à l’esthétique audacieuse, car exubérante, jouant avec les limites du mauvais goût sans jamais y sombrer. Ce foisonnement baroque, fellinien par moments, évoque le meilleur du cinéma de Terry Gilliam (Les Aventures du baron de Münchhausen). Dès le début, avec les raccords plastiques et les transitions sonores assurant le passage d’une séquence à une autre, George Miller déploie une mise en scène d’une inventivité à nulle autre pareille, dont l’une des idées les plus marquantes est une rime entre deux déglutitions à quarante minutes d’intervalle. Peut-être que son inspiration l’a même conduit à encourager son compositeur, Tom Holkenborg à s’imprégner du beau thème d’amour de La Folie des grandeurs composé par Michel Polnareff pour la musique que joue le roi Salomon afin de séduire la reine de Saba. En raison de sa prolifération, nous parions que ce long-métrage de l’Australien arpenteur de l’imaginaire aurait plu à Alain Resnais.
Cependant, là où l’œuvre surprend le plus, c’est dans son mouvement final. Car contre toute attente, le récit jusque-là délirant, se replie sur une romance modeste entre les deux protagonistes. Les séquences sont dès lors d’une durée plus concentrée, clôturées par des fermetures au noir qui s’invitent de manière inattendue. Le cinéaste étonne toujours en se permettant une déviation étrange dans le récit, où l’héroïne a un échange tendu contre son voisinage réactionnaire, avec qui elle se réconciliera dans une séquence suivante. Car le génie redonne la joie de vivre à Alithea (elle était recroquevillée sur ses recherches, blessée par l’unique amour qu’elle a connu et qui n’a pas survécu), il la rend plus tolérante et lui fait abandonner l’autisme dans lequel elle s’était enfermée. Cette douceur se teinte malgré tout d’amertume lors d’une mésaventure finale tout aussi inattendue et que nous ne révélerons pas.
Dans un bref entretien qu’il a donné à Première, George Miller prétend qu’il laisse le public interpréter comme il le souhaite ses histoires qu’il dit allégoriques. Je me permets donc de faire part de mon interprétation. De mon point de vue, bien qu’alambiqué dans sa construction, le film énonce un propos simple. Il fait l’éloge des vertus de la fiction dans un monde occidental devenu techniciste. Ce dernier est symbolisé par l’un de ses épicentres, la mégalopole Londres, où se joue le dernier acte. La ville est présentée comme anxiogène du fait de la suprématie de la science et de la technique étouffant la vie spirituelle. Le génie, dont le corps est affecté par les innombrables ondes électromagnétiques, en fait l’épreuve directement. Le réalisateur déclarait dans le numéro de Positif de novembre 2016 : « Il me semble que c’est en mariant la technologie à une histoire que l’on peut progresser, innover, aller vers des inventions nouvelles. » Ce désir de narration l’a peut-être conduit à se tourner vers l’Orient. Dans son essai sur Lost Highway, Guy Astic précise : « Enracinée dans l’instinct, la sensibilité orientale s’attache au caractère énigmatique des phénomènes et à l’insondabilité de l’existence. Nul savoir, nul a priori n’obscurcissent sa conscience de la limitation de l’homme et son égarement dans l’univers.[1] » Ces mots prennent tout leur sens, lorsque Zefir, une assoiffée de savoir demandant au génie de l’abreuver de connaissances, se lance dans de longues recherches mathématiques. Un plan large en plongée, constellé de formules algébriques, la ramène alors à sa petitesse et sa solitude dans un cosmos qui la dépasse malgré son désir de le rationaliser. Au début du film, Alithea, lors d’une conférence, explique que la science se substitue aujourd’hui aux récits, que ces derniers ne sont plus à même de rendre le monde intelligible, participant au fameux « désenchantement du monde » qu’a constaté Max Weber. Sans réprouver les progrès liés à la technique, George Miller s’inscrit en faux, réaffirmant la nécessité de la croyance et des histoires. Sylvain Angiboust a écrit dans son texte sur le cinéaste : « [George Miller] s’inscrit dans la tradition des récits mythologiques qui utilisent le biais de la fiction merveilleuse pour expliquer le monde dans lequel nous vivons. » Lorsqu’il se libère de sa lampe, le génie met en route ses histoires. Cela équivaut à se libérer de la « cage de fer » du même Max Weber dans lequel sont enfermés les citoyens les sociétés occidentales capitalistes. Le dernier évènement de l’épilogue est à ce titre révélateur. Dans un parc, rappelant l’impératif de revenir à la nature, le génie fait faire un mouvement magique à un ballon de football après avoir tiré dedans, offrant de l’émerveillement à des enfants et stimulant leur imaginaire. L’héroïne du film également narratrice, choisit d’ailleurs d’évoquer son histoire, qu’elle garantit comme vraie, au passé par le biais du conte afin de la rendre plus accessible. Soit l’illustration de ce que le critique cité plus haut notait à propos de l’ouverture de Mad Max 2 : « […] l’histoire à laquelle nous allons assister fait […] déjà partie du passé de celui qui la raconte. C’est un évènement fondateur, lointain et transfiguré par le souvenir, soit la définition même du mythe. »
Tancrède Delvolvé
Three Thousand Years of Longing. Film américano-australien de George Miller (2022), avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagun, Nicolas Mouawad. 1h48.