Numéro 651 – Le Fils de Saul de László Nemes

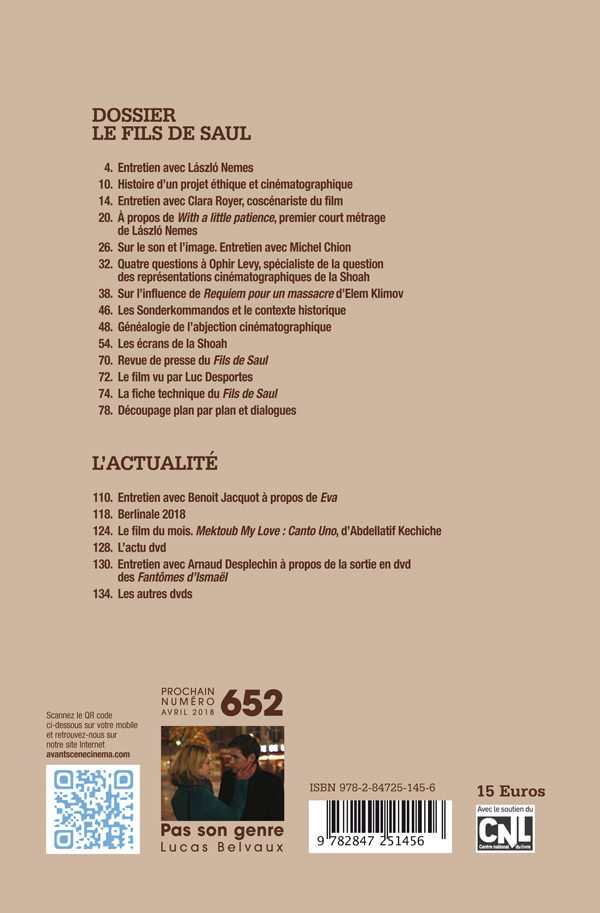
Pour commander, cliquez ici
Dossier Le Fils de Saul de László Nemes
Entretien avec Clara Royer, coscénariste du film
Romancière, scénariste et chercheuse, Clara Royer est née à Paris en 1981. Ancienne élève de l’École normale supérieure, titulaire d’un doctorat en histoire et en littératures hongroise et slave, elle est devenue maître de conférences à l’Université Sorbonne. Depuis 2015, elle dirige le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague. Elle est l’auteur d’un roman, Csillag (Pierre-Guillaume de Roux), en 2011, et d’un essai biographique, Imre Kertész : L’histoire de mes morts (Actes Sud), en 2017. C’est en cherchant à se familiariser avec la langue de ses ancêtres maternels qu’elle fait la rencontre de László Nemes avec lequel elle se lie d’amitié avant d’entreprendre une collaboration artistique fertile cinq ans plus tard. Coscénariste du Fils de Saul, qui marquait ses débuts dans ce domaine, Clara Royer a écrit, avec Matthieu Taponier et le réalisateur, le script de son deuxième long métrage, Sunset. Elle revient ici sur son baptême du feu de scénariste et sur les principaux enjeux liés à la représentation des Sonderkommandos, ces groupes de déportés, juifs pour la plupart, chargés par les nazis de manipuler les cadavres de leurs camarades assassinés.
Dans quelles circonstances avez-vous rencontré László Nemes ?
Clara Royer : J’ai rencontré László en 2002 quand, après trois mois de cours du soir à l’Institut hongrois, j’ai voulu passer à la vitesse supérieure. À l’époque il travaillait peut-être comme troisième assistant sur un court métrage, mais à la fin de l’année, il a quitté Paris pour s’installer en Hongrie et se donner une vraie chance dans le cinéma. Quant à moi, je venais de découvrir la littérature hongroise, et le désir d’en lire davantage était venu donner une raison légitime à ce qui n’était jusque-là qu’une curiosité familiale et linguistique. J’avais aussi prévu de faire un séjour à Budapest l’année suivante. Je ne suis pas tout à fait sûre que László m’ait appris le hongrois, mais ces premières conversations sur la langue et sur les poèmes que nous traduisions pour m’entraîner ont beaucoup compté dans notre amitié naissante.
Pourquoi László Nemes vous a-t-il proposé de travailler avec lui sur Le Fils de Saul, alors même que vous n’aviez aucune expérience dans le domaine du cinéma ? Est-ce-lié à vos travaux universitaires ou à votre roman Csillag dont Le Monde louait en 2011 « le style taillé comme un arbuste à la fin de l’hiver » ?
C. R. : Ce dont je me souviens, c’est qu’à l’été 2008, alors que je terminais ma thèse, László m’a parlé d’un autre projet de long métrage : nous nous sommes mis à échanger des idées et soudain il m’a demandé si ça ne m’intéresserait pas d’écrire avec lui. Pendant deux ans, nous avons appris à travailler ensemble et c’est à mes yeux le grand mérite de ce projet qui n’a pas abouti. Mais établir un lien entre mon style romanesque et l’écriture scénaristique est un peu risqué. D’un côté j’ai dû « désapprendre » beaucoup de mes automatismes d’écriture, et le processus n’a pas été sans douleur. De l’autre, l’écriture plus épurée, mais aussi plus sensorielle et partant, plus sensuelle, qui est celle du scénario, me convenait et cette expérience imprègne certainement aujourd’hui mon style quand j’écris des livres.
Vous souvenez-vous de la toute première fois où vous avez évoqué le projet du Fils de Saul avec László Nemes ? Avez-vous formulé des réserves ?
C. R. : La première fois que je l’ai entendu évoquer l’idée d’un film en lien avec les Sonderkommandos, c’était en 2007, quand je suis revenue vivre à Budapest. À l’époque, nous ne travaillions pas ensemble, je l’ai donc écouté sans me sentir concernée autrement qu’en tant qu’amie. Puis nous avons commencé à écrire ensemble. Je savais que László nourrissait toujours le désir de faire un film sur ce thème mais il en parlait très peu, je crois qu’il laissait le projet mûrir en lui. Un soir, c’était à l’été 2010, László m’a dit qu’il pensait avoir trouvé l’histoire qu’il voulait mettre en scène. Il souhaitait raconter « l’histoire d’un homme qui travaille dans un Sonderkommando et qui reconnaît, parmi les cadavres qu’il doit faire disparaître, son fils, qu’il décide d’enterrer ». Cette phrase a été un tournant : je lui ai dit que je voulais écrire cette histoire avec lui, et que nous devions l’écrire maintenant : elle était viscérale, nécessaire, elle était évidente. C’est ainsi qu’a démarré le projet.
Peut-on considérer les courts métrages de László Nemes comme des esquisses du Fils de Saul, plus particulièrement With a Little Patience, déjà loué en 2007 « pour le traitement inhabituel de ce sujet délicat », et quel parti en avez-vous tiré dans l’écriture ?
C. R. : Avec With a Little Patience, László réfléchissait déjà à la question de la limitation du point de vue et à son impact sur la perception du spectateur, et ce travail anticipait bien sûr celui qu’il a mené dans Le Fils de Saul. Nous avons intégré dès l’écriture un certain nombre de principes visuels, tels que le gros plan, le flou et le hors-champ, parce que nous voulions proposer une expérience à hauteur d’homme de ce qu’avaient pu être les camps de la mort. Un personnage comme Saul, qui s’est habitué à l’horreur de son travail pour survivre, ne perçoit pas les choses pour la première fois, il ne voit plus, n’entend plus l’horreur que l’on montrait traditionnellement à l’écran. Revenir au point de vue individuel, suivre Saul pas à pas, c’est refuser de mettre le spectateur en haut d’un mirador ou lui donner un point de vue surplombant qui n’a jamais été celui de ceux dont nous voulions parler à travers lui.

Le fait de devenir scénariste était-il une évidence pour l’universitaire que vous êtes ?
C. R. : Non, cela n’avait rien d’évident pour moi. Je voulais écrire des romans, et l’université était un lieu où je pouvais le faire. Je n’avais jamais rêvé de devenir scénariste, et initialement, si je me suis engagée dans cette voie, c’est parce que je croyais dans la vision de László et que je partageais son besoin de raconter ces histoires.
Quel a été votre rôle exact d’un point de vue historique ?
C. R. : Le Fils de Saul a été une gageure sur le plan historique. Jusque-là, je m’étais bien gardée de travailler sur la Shoah. Je travaillais sur l’entre-deux-guerres et l’Après-guerre, et j’avais aussi édité un livre sur l’extermination des Juifs de Hongrie pour la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, mais je n’avais jamais mené de recherches sur l’extermination des Juifs et encore moins sur les Sonderkommandos. Mon travail d’historienne s’est limité à celui de lectrice. Et il y avait quantité de sources et d’ouvrages à lire… Nous avons aussi consulté plusieurs historiens spécialistes des Sonderkommandos – il ne faut pas oublier que c’était un sujet tabou pendant des décennies et qu’il y a eu un récent travail historiographique important. Nous avons donc beaucoup discuté avec Philippe Mesnard en France, Gideon Greif en Israël et Zoltán Vági en Hongrie. Nous avons aussi engagé pour quelques mois une chercheuse en thèse, Julia Maspéro, pour obtenir le plus de précisions possibles sur l’automne 1944 à Auschwitz-Birkenau, et en particulier sur l’insurrection des Sonderkommandos du 7 octobre.
Comment s’est organisé le travail d’écriture proprement dit ? A-t-il été précédé de recherches historiques ponctuelles et, si oui, de quel ordre ?
C. R. : Nous avons commencé à écrire Le Fils de Saul à Budapest, puis je suis revenue à Paris et László m’a rejointe très vite grâce au soutien de la Résidence du Festival de Cannes. László méditait le projet depuis 2005 et sa lecture de Des voix sous la cendre. Il était tombé dessus dans une librairie en Corse. C’est sous ce titre qu’ont été publiés pour la première fois en français les manuscrits écrits par des membres du Sonderkommando que l’on a retrouvés après la guerre à Birkenau. Quant à moi, j’avais déjà lu le témoignage de Miklós Nyiszli, un médecin juif de Transylvanie qui est devenu le médecin-légiste de Josef Mengele en 1944, et ces textes ont été des sources majeures pour nous. La recherche historique a accompagné l’écriture proprement dite tout du long.
Qu’ont apporté à votre processus d’écriture vos séjours successifs dans le cadre de la Résidence de la Cinéfondation et du Jerusalem International Film Lab ?
C. R. : Sans ces soutiens je ne suis pas sûre que nous aurions porté ce projet à son terme. C’est grâce à la Cinéfondation que László et moi avons pu écrire une première version du scénario pendant six mois à Paris, et c’est au Jerusalem International Film Lab que nous avons pu nous orienter vers ce qui serait la version du tournage – c’est là notamment que nous avons approfondi les relations entre les personnages. Ce séjour à Jérusalem, aussi court qu’il ait été, a été un tournant personnel : c’est là où j’ai compris que j’avais pris goût à l’écriture scénaristique.
Le fait d’aborder la Shoah frontalement constituait-il un tabou dans la Hongrie des années 2010 et, si l’on a essayé de vous dissuader de travailler sur un tel projet, quels étaient les arguments évoqués ?
C. R. : C’est une question amusante que vous posez parce que, en réalité, en dehors du soutien de la Cinéfondation, c’est en France où l’on nous a opposé le plus de refus, quand on nous répondait seulement d’ailleurs. Nous voulions faire un film français mais nous nous sommes fait rétorquer plus d’une fois que nous étions anachroniques avec ce sujet-là. Par ailleurs, qui prendrait le risque de parier sur un débutant inconnu comme László ? Pourtant, lorsqu’il a soumis le projet à Gábor Sipos, l’un de nos producteurs hongrois, il n’a pas eu d’hésitation, et c’est grâce au Centre national du cinéma hongrois, le Magyar Nemzeti Filmalap, que ce film a pu se monter.

Avez-vous perçu cette complexité à « dire l’indicible » qui a été pointée si souvent à propos de la représentation de la Shoah ?
C. R. : Nous voulions rompre avec la banalisation des chiffres et des clichés, avec la routine de la représentation de la Shoah au cinéma. Nous voulions parler des morts, c’est-à-dire de ceux qui n’ont pas survécu, et nous ne voulions pas parler des résistants héroïques. Le survivant et le héros sont deux figures exceptionnelles dans l’histoire de l’extermination des Juifs. Nous avons donc choisi un personnage entre la mort et la vie, plongé au cœur du mal du système concentrationnaire, et qui n’est pas loin de l’antihéros. Ce refus d’un récit héroïque au profit de l’histoire d’une quête obsessionnelle a déterminé tout le scénario. Elle est d’autant plus visible qu’elle contraste avec l’insurrection des Sonderkommandos qui se prépare et qui, dans le film, est incarnée par Ábrahám.
Comment avez-vous essayé de résoudre cette difficulté sur le plan narratif ?
C. R. : Quand on propose un film sur un sujet comme celui-ci, qui a suscité, et à raison, plus d’un débat sur la représentation, il est évident que la démarche esthétique s’inscrit dans une réflexion éthique. Nous étions conscients des débats sur la question en France et en Allemagne en particulier, mais nous avons voulu proposer une expérience, quelque chose qui ne répondait pas avec des idées mais avec des émotions : celles que suscite le visage de Saul, celles que suscite son pas à pas dans l’espace du crématoire et du camp. C’est un espace où les normes, les valeurs du spectateur, n’ont aucun sens, et comme il traverse avec Saul une expérience physique, il est plus engagé que dans un film qui joue sur la corde pathétique. Pour moi, je ne voulais pas écrire une histoire consolatrice, ou qui provoque les larmes de la bonne conscience, que l’on oublie aussitôt rentré chez soi après s’être dit, quand même : « J’ai du cœur, cela m’a fait bien de la peine tout ça. » Le langage que László a créé avec ce film ne dit pas autre chose que : voilà l’homme, voilà ce dont il est capable – tout le reste, ce sont des questions douloureuses qu’il appartient à chaque spectateur de laisser vivre en lui.
Au stade de l’écriture, quelles références avez-vous convoquées, sur le plan pictural et cinématographique ?
C. R. : Évidemment, Shoah de Claude Lanzmann a été une référence cruciale, de même que Requiem pour un massacre d’Elem Klimov qui nous a beaucoup marqués, même si les deux films ont des styles très différents. A contrario, il y a eu des films ou des scènes qui nous ont servi de repoussoir – je me rappelle une séquence dans laquelle des prisonniers bavardent pendant « l’appel » comme s’ils étaient dans un salon de thé… Dans Le Fils de Saul, la première scène de l’appel ne fait entendre que la liste des numéros des détenus. Nous avons aussi beaucoup réfléchi à partir des célèbres photos des Sonderkommandos. Le film y fait une allusion et si l’on peut reconnaître la photo qui nous a inspirés, la scène évite toutefois la reconstitution. La photo qu’on essaie de prendre dans le film est ratée et probablement perdue, puisqu’elle est interrompue par une inspection surprise. J’étais pour ma part aussi nourrie de références littéraires – outre Primo Levi, Le Monde de pierre du Polonais Tadeusz Borowski et Être sans destin du Hongrois Imre Kertész : ce sont des textes dont l’écriture offre une radicalité que l’on ne retrouvait pas dans le cinéma de fiction sur la Shoah mais dont il me semblait qu’ils pouvaient nous aider à élaborer ce nouveau langage que László voulait créer.
Comment vous êtes-vous réparti les tâches au fil de l’écriture ?
C. R. : Le Fils de Saul est le premier scénario que j’aie jamais achevé – il a été mon école de cinéma, si l’on veut. Au début, il y a eu beaucoup de conversations entre László et moi pour déterminer la structure de l’histoire et créer notre personnage principal, beaucoup d’échanges sur nos lectures – c’est moi qui prenais les notes. Comme je venais du roman, la rédaction du « traitement », qui correspond à une nouvelle, m’est revenue, et c’est avec cela que nous avons postulé à la Cinéfondation. Puis c’est László qui a écrit la première version du scénario : il m’envoyait les scènes au fur et à mesure, je proposais des changements, il me renvoyait la scène, etc. Aux versions suivantes, László et moi nous sommes répartis les scènes – il nous arrivait souvent d’écrire en face l’un de l’autre, chacun derrière son écran d’ordinateur, et quand nous avions terminé une scène, nous attendions tout impatients que l’autre la lise et fasse ses commentaires avant de replonger derrière l’écran et de continuer.
Sur combien de temps s’est échelonné votre travail d’écriture et s’est-il heurté à des obstacles ponctuels ?
C. R. : Nous avons écrit de 2010 à 2014, avec des interruptions bien sûr, même si le scénario était à peu près prêt à l’automne 2013. Mais l’écriture en tant que telle va jusqu’aux sous-titres, pour lesquels nous avions aussi une poétique propre, en raison du rapport singulier aux langues de notre protagoniste.
Quelle a été la séquence la plus compliquée à écrire et pourquoi ?
C. R. : J’ai du mal à identifier une séquence en particulier. Pour moi, mais j’ignore ce que dirait László, toutes les séquences ont été difficiles à écrire, ne serait-ce qu’émotionnellement. Toutes posaient des questions visuelles et éthiques, historiques et spatiales, etc. Sur le plan dramatique, nous avions une histoire dont il fallait préserver la simplicité à tout prix. Je peux vous donner en exemple la scène entre Saul et la jeune femme qui doit lui remettre la poudre pour les explosifs dans « le Kanada », ainsi qu’on appelait en langage des camps l’entrepôt où étaient triés les biens volés aux déportés. Nous voulions une scène dans laquelle Saul, en proie à son obsession d’enterrer son fils, tourne le dos aux vivants, incarnés par le visage d’une jeune femme dont on suppose qu’ils se sont connus. Il s’agissait aussi d’évoquer le rôle qu’ont joué les femmes dans l’insurrection des Sonderkommandos. Finalement, après beaucoup de discussions entre nous, nous avons banni tout dialogue pour montrer une rencontre qui ne se fait pas.

Quel rôle exact le monteur Matthieu Taponier a-t-il joué dans l’écriture du film a posteriori ?
C. R. : Matthieu a été très rapidement associé au projet puisqu’il a agi comme consultant sur le scénario dès que nous avons abouti à la première version en 2011. Comme le montage a été déterminé pendant le tournage, sur lequel il était tous les jours, je ne crois pas qu’on puisse parler de réécriture a posteriori. D’ailleurs, je crois que seule une scène n’a pas été incluse dans le film – on peut la voir en revanche dans le DVD du film avec les commentaires de László et de Matthieu.
Vous avez déclaré que l’écriture du scénario vous avait enseigné qu’un tel sujet implique une extrême économie de dialogue. Comment avez-vous procédé et ce processus a-t-il accompagné tout votre travail d’écriture ?
C. R. : Cela a été pour moi l’une des grandes leçons entre la première et la dernière version du scénario. Dans la première version, je m’étais par exemple attachée à donner des backstories à une partie des personnages secondaires et il y avait en particulier une scène dans laquelle ils devaient les révéler, celle dans laquelle ils mangent. Mais nous nous sommes rapidement aperçus avec László que ces phrases sonnaient faux, parce que ce lieu qu’est le crématoire n’est pas propice aux souvenirs nostalgiques. Le passé, on le laisse derrière soi, tout est tendu vers la survie immédiate, c’est le présent dans toute son épaisseur qui retient la conscience. Quant aux mots des prisonniers, ils ont subi un appauvrissement et une transformation radicales. Je crois que c’est dans Nous avons pleuré sans larmes, le livre d’entretiens que Gideon Greif a conduits avec des survivants du Sonderkommando en Israël, que l’un d’eux raconte qu’on ne connaissait généralement pas le prénom des autres détenus avec lesquels on travaillait, et qu’on se contentait de s’interpeller par un « du ! » (« toi ! »). Ce dénuement du langage entre en résonance avec la Babel de langues dont László et moi étions très conscients dès le premier stade de l’écriture. Dans le camp, il faut créer aussi un langage entre des êtres qui parlent des dizaines de langues différentes, et cela suppose une communication réduite au plus essentiel. Nous avons choisi pour cela aussi un protagoniste qui ne parle bien qu’une langue, le hongrois, et ne comprend pas tout ce qui se dit autour de lui, notamment en allemand et en yiddish.
Avez-vous aspiré au réalisme ou un tel sujet interdisait-il sa représentation littérale ?
C. R. : Je suis assez sûre que nous n’en avons pas parlé en ces termes entre nous. De toute façon, je ne crois pas qu’une représentation littérale soit possible ni souhaitable. Nous avons tâché de rester au plus près de ce qu’a pu être l’expérience des détenus du Sonderkommando, et c’est pourquoi, par exemple, nous avons tenu à montrer comment cette usine de la mort était aussi un endroit chaotique et arbitraire. Nous voulions respecter les morts, aussi nous avons en général renoncé à utiliser les noms des personnages historiques qui nous avaient inspirés. Le film est fondé sur un équilibre entre la précision des détails historiques et un récit très simple qui puisse parler à tous : celui d’un homme qui veut enterrer son fils, ce qui est l’un des premiers gestes de l’humanité. D’aucuns ont vu là une réécriture du mythe d’Antigone, d’autres y ont lu un conte : dans son livre Sortir du noir, Georges Didi-Huberman parle d’un conte yiddish et de Kafka. Nous n’avions pas pensé à cela, mais je pense que ces interprétations pointent vers la dimension archétypale de l’histoire que nous avons voulu raconter.
Propos recueillis par Jean-Philippe Guerand













