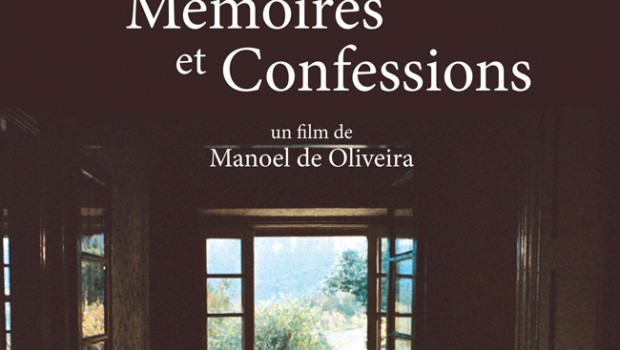La Visite ou Mémoires et Confessions, de Manoel de Oliveira
À propos de La Visite ou Mémoires et Confessions
Oliveira : malice et éternité
En 1981, Manoel de Oliveira vient de tourner Francisca. Il travaille déjà sur Non ou La Vaine Gloire de commander qu’il tournera en 1990 et L’Étrange Affaire Angelica qu’il ne tournera qu’en 2011*. Comment cet homme de 73 ans, réalisateur de 6 films, peut-il imaginer qu’il lui reste 34 ans à vivre, 25 longs métrages à réaliser, qu’il travaillera jusqu’au dernier instant, qu’il créera son dernier film, O velho do Restelo en 2014 ? Quelle sorcière, quel Tirésias sorti des Enfers eurent pu le prévenir d’un destin aussi prodigieux ?
Il est à peu près certain que le hasard n’a offert à aucun autre artiste une telle étendue de temps pour sa création, peut-être à aucun homme pour son métier sur la Terre. 1981, c’est pour lui le moment d’une douleur profonde. Après les grèves consécutives à la Révolution des œillets de 1975, dont il fut pourtant un partisan enthousiaste, l’usine familiale de passementerie, héritée de son père, a périclité. Ses dettes le contraignent à vendre la maison qu’il a fait construire quarante ans auparavant à Porto par l’architecte José Porto. Le bâtiment, magnifique, est marqué par l’influence de l’avant-garde française. Dans cette maison, bâtie après son mariage avec Maria Isabel Brandão Carvalhais, enfants et petits-enfants, projets, naissances, disparitions, espoirs, bonheurs et regrets ont banalement ponctué les années. Le jardin, les arbres ont grandi avec le temps. Des projets de musée, de récupération par la mairie de Porto ayant échoué, il se résigne à la céder à un acheteur privé. Il conçoit alors un film pour célébrer ce lieu bientôt abandonné, mais un film que nul ne pourra voir avant sa mort. Le soutien financier de l’État portugais fut même lié à cette condition. Un négatif et une copie 35 mm furent déposés et conservés à la Cinémathèque portugaise. Elle se chargea, par des sauvegardes successives, de conserver l’œuvre intacte, alors qu’Oliveira semblait ne jamais devoir mourir. Lui-même, voyant le tour que lui jouaient les dieux, envisagea un moment d’en réaliser une nouvelle version.

La pudeur et le néant
Pourquoi voulait-il que ce film fût posthume ? Deux explications. La pudeur d’abord. Ce n’est pas qu’il y fasse de grandes révélations, que des scandales y surgissent. Mais la caméra parcourt tous les lieux, jusqu’aux plus intimes, la chambre conjugale, la salle de bains, les meubles couverts de photos familiales. Rien de bien extraordinaire, et pourtant, si l’on y pense, quoi de plus sensible, de moins public que ces images-là ? Puis, avec réserve, avec une timidité évidente et qui trouble quand on songe à ce qu’il avait prescrit du sort de son film, Oliveira comparaît, face à sa propre caméra et parle de ses parents, de ses grands-parents, de son mariage, de ses enfants, de ses mésaventures financières, de son rapport à la pureté, à la virginité, à l’esprit, au cinéma. Il libère sans doute sa parole en sachant qu’elle ne sera entendue qu’après sa disparition. La seconde explication découle de la première. Le temps de l’intimité prend un nouveau visage après la mort de celui qui l’a connue. Sartre écrit : « D’ailleurs, la mort, en tant qu’elle peut se révéler à moi, n’est pas seulement la néantisation toujours possible de mes possibles – néantisation hors de mes possibilités – elle n’est pas seulement le projet qui détruit tous les projets et qui se détruit lui-même, l’impossible destruction de mes attentes : elle est le triomphe du point de vue d’autrui sur le point de vue que je suis sur moi-même. » Oliveira, en décidant de ce qu’on verra de lui après, conjure en partie ce risque d’être la proie du point de vue d’autrui. Il construit, avec un humour bien caché, mais toujours présent dans son œuvre, le complot de sa propre postérité. Sub specie aeternitatis.
Cet humour, il le bâtit avec le dispositif narratif de son film. Comme toujours dans son œuvre, c’est un dispositif très simple, mais radical, et génial. Six modes du récit : des visiteurs invisibles, lui-même devant la caméra, un témoignage de son épouse, des films de famille, des paysages et des maisons appartenant à sa mémoire, une courte reconstitution fictionnelle.
Les visiteurs invisibles
Le film s’ouvre en même temps que le portail de la maison. Deux voix, celle de Teresa Madruga et du fidèle Diogo Doria, se font entendre. Leurs paroles ont été écrites par Augustina Bessa-Luis, dont Oliveira adaptera le roman Val Abraham en 1993 et Le Principe de l’Incertitude en 2002. Ces visiteurs expliquent une partie du titre du film. Ils parcourent la maison, où ils ont « des amis ». Mais ces amis ne sont nulle part. La maison, remplie de ses meubles, intacte, avec des fleurs fraîches sur les tables, une cuisine qu’on vient d’utiliser, des objets à peine lâchés par leurs propriétaires, la maison est pourtant vide de tout être humain. Les « visiteurs » ne reconnaissent personne sur les photographies qu’ils rencontrent. Avec leurs voix (on ne les verra, eux, jamais à l’écran), on entend leurs pas. Qui sont peut-être seulement les pas du cadreur. Qui sont ces visiteurs de cette maison vide ? Des fantômes ? Ou plutôt n’est-ce pas la maison elle-même qui est déjà fantôme ? Elle est filmée pour plus tard. Elle est déjà morte. Car Oliveira l’a déjà vendue et abandonnée malgré lui. Et ses occupants sont morts aussi, puisque le film ne sera vu qu’en ce temps-là, dans un futur imprévisible, soumis au hasard du temps, un temps où nous sommes parvenus, nous les spectateurs de cet avenir-là enfin accompli. Les « visiteurs », ce sont Les Autres, du film de 2001 d’Alejandro Amenábar, c’est le visiteur qu’interprète la voix d’Alain Cavalier dans des films tels que Bonnard en 2006 ou Irène en 2009. Ces visiteurs prononcent de profondes paroles sur ce que signifie habiter une maison, sur ce que signifient les différents âges de la vie, tout en s’inquiétant de ne pas trouver ceux qu’ils cherchent. Leur inquiétude est liée à une question philosophique, et cinématographique, très simple. Les choses existent-elles encore quand plus personne n’est là pour les percevoir ? Le monde peut-il exister sans aucun regard sur lui ? Ainsi les visiteurs peuvent s’interroger sur l’âme des arbres et voir dans le grand palmier devant le seuil de la maison, un portier boudeur et mécontent, « comme tous les portiers ». Très clairement, ces visiteurs sont des intrus, ils sont entrés sans permission, ils violent l’intimité, comme des cambrioleurs, et n’en sont eux-mêmes pas très fiers. Ils sont, comme tous les cinéastes, des voyeurs, et n’en sont pas rassurés. À un moment, ils entendent du bruit. On passe alors à Oliveira lui-même. Mais on entendra à nouveau les deux visiteurs.

Avoir le trac
Dans son bureau, devant sa bibliothèque, Oliveira parle aux spectateurs du futur, un futur un peu plus lointain qu’il a pu l’imaginer. Cette légère altération de la voix, cette raideur du corps, cette timidité d’un homme pourtant sûr de son art face à sa propre caméra ne peut s’expliquer que d’une seule façon. Oliveira a le trac. Parce qu’il parle devant un gouffre : le temps où il sera disparu, absent, mort. Comment éviter le vertige ? Il pourra, à la fin du film, conclure sur sa propre présence en la qualifiant, lucide et impitoyable, d’« infinitésimale ». Son dispositif malicieux lui permet de dire, à propos de sujets plus ou moins graves, ce qu’il ne peut pas dire de son vivant. Et de mêler à sa tristesse, très actuelle, contemporaine de la vente de sa maison, une mélancolie anticipatrice que gomme pourtant son parti pris artistique parfaitement maîtrisé.
Son épouse, Maria Isabel, paraît à son tour. Elle aimait la peinture, elle est devenue jardinière et protectrice compréhensive de l’œuvre de son mari. Elle parle tandis que s’incrustent sur l’écran les photographies de son visage de jeune fille. On verra aussi, avec beaucoup de photos, de petits home movies pris à différentes époques dans l’espace de la maison qui s’évanouit. Le projecteur qui diffuse ces films est visible à l’écran, comme dans le générique de Mean Streets de Scorsese, près du cinéaste. Sur la bande-son, le bruit du défilement de la pellicule se fait insistant, et occupe même des instants où plus rien ne justifie son cliquetis obsédant. On verra aussi des ruines (la maison des ancêtres), d’autre lieux et paysages (la maison d’enfance de Maria Isabel, des paysages familiers pour Oliveira), filmés par les longs panoramiques qu’on retrouve dans Val Abraham.
L’éclipse
Enfin, inopinément, Oliveira raconte son arrestation par la PIDE, la police fasciste de Salazar, en 1963. Et nous montre quelques images, en caméra subjective, de cette arrestation, filmée avec des comédiens, dans des décors aux apparences authentiques de prison, de siège de la police. Quelques jours de détention, humiliants, inexpliqués. Et le passage furtif d’un compagnon d’infortune, apparemment interprété par lui-même vingt années plus tard.
À la fin du film, génialement, le bruit du projecteur devient le bruit de son mécanisme tournant à vide. Il n’y a plus de pellicule, plus d’image sur l’écran. Cet écran blanc, cette machine qui a perdu son aliment, succèdent à la conclusion de Manoel le rusé : « Je me souviens de moi. Et je m’éclipse. » n
René Marx
Réal. : Manoel de Oliveira. Dial. : Augustina Bessa-Luis. Phot. : Elso Rocque. Voix off : Teresa Madruga et Diogo Doria.
Dist. : Epicentre Films. Durée : 1h10. Sortie France : 6 avril 2016.