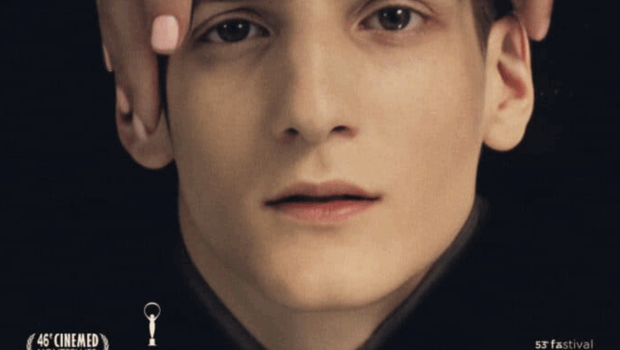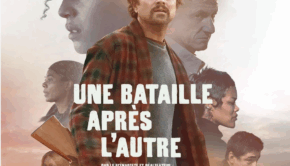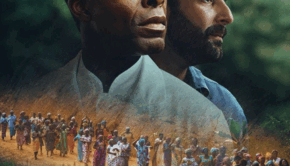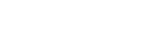Panopticon
Panopticon
Le titre du film, qui renvoie au philosophe anglais Jeremy Bentham et à la
critique qu’en fit Michel Foucault, évoque l’idée diffuse de surveillance. Le
personnage principal, Sandro, un adolescent livré à lui-même, se cherche, dans
une société qui ne fait rien pour l’aider : sa mère travaille à l’étranger, son père
s’apprête à devenir moine, son meilleur ami appartient à une milice raciste et
réactionnaire, et lui-même est déchiré entre ses pulsions sexuelles et la foi qui
le corsette. Pas étonnant que le jeune homme promène son mal-être d’un lieu à un
autre, se sentant sous la surveillance de Dieu et des Hommes, mais surtout de
lui-même. Le réalisateur géorgien George Sikharulidze a un sens inné de la mise
en scène (composition du plan, travail sur la lumière) et du montage
(extrêmement dynamique au sein des scènes, et jouant habilement des ellipses),
proposant un premier long métrage virtuose et impressionnant. Un peu trop,
peut-être. Car si les séquences se succèdent avec brio, le scénario, lui, patine
rapidement. Les situations destinées à montrer que tout contribue à étouffer le
personnage se multiplient (les échanges frustrants avec le père, les tentations
érotiques, le catalogue ambigu de modèles de virilité), tout comme les ressorts
voyants et prévisibles, entre langueur ton sur ton et surenchère dramaturgique.
Il doit ainsi sans cesse se passer quelque chose : un malaise, une agression, un
deuil… sans que cela fasse pour autant véritablement avancer l’intrigue. Le
personnage peine alors à sortir de la posture archétypale dans laquelle l’enferme
le récit et, lorsqu’il évolue enfin, cela semble plus un effet d’écriture que le
résultat d’un réel cheminement personnel.
Marie-Pauline Mollaret
Film géorgien de George Sikharulidze (2024), avec Malkhaz Abuladze, Data
Chachua. 1h35.