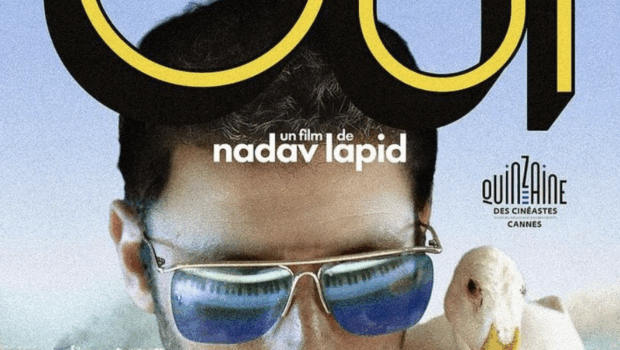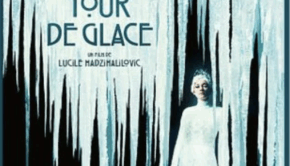Oui
Oui
Peut-on séparer un long métrage de son contexte, historique, sociologique ? La
sortie du dernier film de Nadav Lapid est une illustration chimiquement pure de
cette question, tant l’œuvre en elle-même semble inextricablement liée à la
situation présente à Gaza, à la fois dans son propos, ses plans, ses thèmes, mais
également la pertinence même de son apparition. Les rumeurs, nombreuses et
plutôt cohérentes entre elles, ont toutes semblé pointer vers une même
conclusion : c’est cette pertinence même qui aurait coûté à Oui une place en
sélection officielle cannoise, pour se retrouver finalement accueilli avec les
égards dus à la Quinzaine des Cinéastes, qui a pu s’offrir le luxe d’un auteur déjà
détenteur de l’une des principales récompenses du circuit des festivals
internationaux (l’Ours d’or, pour Synonymes). Ce mini scandale cannois peut
sembler anecdotique, mais il illustre bien évidemment la crispation actuelle des
positions et des idéologies. Le long métrage ne fait rien pour éviter cette
tendance, puisqu’il assume en intégralité une charge politique, voire pamphlétaire,
qui semble souvent se poser comme sa raison d’être. Mais Oui reste une œuvre
de cinéma, et non un discours ou une mise en accusation, aussi nécessaires qu’ils
puissent être, et c’est à ce titre qu’il faut le regarder : comme une mise en
abyme de cette situation même, posant précisément la question de l’art et de la
création, de sa possibilité, dans la violence du monde actuel.
Un monde dénué de place pour l’art
Dès son deuxième long métrage, L’Instructrice, le metteur en scène avait déjà
mis en avant la question de la place de l’art dans une société n’ayant en apparence
pas la moindre à lui offrir. Il est toujours hasardeux de faire des liens parfois un
peu forcés entre les œuvres, mais il y a quelque chose de l’enfant poète de
L’Institutrice dans le protagoniste central de Oui, comme si le chérubin surdoué
avait grandi et sacrifié (ou perdu) sa poésie, ses capacités de création, juste
pour pouvoir s’intégrer à un monde devenu plus froid et violent. Cet anti-héros,
ancien prodige du piano, compositeur frustré réduit au rôle d’animateur de
soirées décadentes, se voit alors proposer une seconde chance lorsqu’il lui est
offert de rédiger, pour un millionnaire idéologiquement aligné avec la droite
dure, la musique d’un nouvel hymne aux paroles particulièrement insupportables,
inhumaines. Oui pousse ainsi plus loin la prémisse de L’Institutrice : l’art n’a plus
de place, mais son sens même est interrogé, attaqué, érodé. Déjà, les deux
précédents films de Lapid mettaient en avant une forme d’impuissance de la
création. Les histoires du protagoniste/cinéaste au cœur du Genou d’Ahed,
autant que celles du jeune homme de Synonymes, s’y heurtaient à la violence de
la société israélienne, dessinant une interrogation presque insupportable : à quoi
bon créer si cela ne peut en rien influer, d’aucune manière, sur un pays dévoré
par une haine grandissante, cela a-t-il seulement un sens ? A ce niveau, Oui pose
un constat terrible. Son protagoniste a en effet mis de côté ses ambitions
créatrices, les a abandonnés pour autre chose (la belle vie, la survie ?) Mais, dans
un retournement plus cruel encore, cette capacité (pouvoir créer de la beauté)
est ici détournée pour s’intégrer à la machine destructrice de la violence
étatique.
Face au grotesque et à l’horreur
Que reste-t-il alors ? Un univers consumé par une laideur visuelle et morale.
Cette laideur, assumée, a toujours été au cœur du cinéma de Lapid, depuis son
premier long métrage, Le Policier (ASC n°690). Elle devient ici plus étouffante
encore, la marque grotesque de tout un pays occupé par des fêtes criantes,
colorées, dans une version absurde et plus vulgaire encore de la dolce vita
fellinienne. La marque esthétique d’une société qui, pour l’auteur, semble avoir
annihilé toute notion de poésie, récupérant ses dernières miettes pour une
propagande nauséabonde. Le pays tout entier semble, dans Oui, un désert vidé de
toute idée de création et peut-être, à travers elle d’humanisme. Une idée
terrifiante qui prend corps lorsque Lapid filme finalement le cœur de l’infamie, la
vision de Gaza bombardée, presque en flammes, observée par le pianiste sur une
colline, lui-même entouré de soldats apparemment peu concernés. L’est-il, lui ?
C’est finalement la seule question qui compte, celle le récit laisse dans une demi-
ambiguïté. Une chose est sûre : il ne se bat plus, que ce soit pour faire exister
véritablement son art, ou pour essayer de renverser la réalité d’un pays, d’une
situation, d’une guerre, dont il est malgré tout un élément, en tant que citoyen. Il
y a dans le film une colère que tous les critiques et tous les spectateurs ont pu
remarquer, mais il est permis de se demander si cette colère n’est pas également
une forme de culpabilité, à l’idée de ne pouvoir peser sur l’horreur actuelle,
d’être un témoin du désastre, tel son personnage sur une colline, lunettes de
longue vue collées aux yeux.
Et maintenant ? La sortie de Oui prolonge sa dimension auto réflexive : quel
impact l’art peut-il avoir en ce lieu, en cette époque. Dans l’une des scènes
centrales du film, des enfants chantent l’hymne au cœur de l’intrigue, avec ses
paroles d’une infinie violence envers les Palestiniens. Lapid a raconté, en
entretien, que les parents des enfants n’ont littéralement eu aucune réaction
devant les paroles en question, qui peuvent sembler à nos oreilles d’une violence
grotesque proche de la caricature. Mais elles ne l’étaient apparemment pas pour
les enfants et leur famille. Pour citer une célèbre expression, la réalité a
dépassé la fiction. Là est peut-être l’enjeu central du cinéma de Lapid dans les
années à venir. Comment parler du monde, comment capturer une réalité lorsque
la société semble avoir dépassé, dans l’horreur, dans l’absurde, tous les
paramètres ? Oui semble ainsi dévoré par une énergie souvent grotesque (avec
des scènes d’humour à la limite du surréalisme) qui peuvent être vues comme une
réponse à cette plongée définitive du pays dans une version moderne et
effrayante d’Ubu roi. Que peut faire la fiction, la poésie, face à cela ? C’est
peut-être cette interrogation qui va dessiner le futur artistique du metteur en
scène.
Pierre-Simon Gutman
Yes. Film franco-israélien de Nadav Lapid (2025), avec Ariel Bronz, Efrat Dor,
Naama Preis. 2h30.