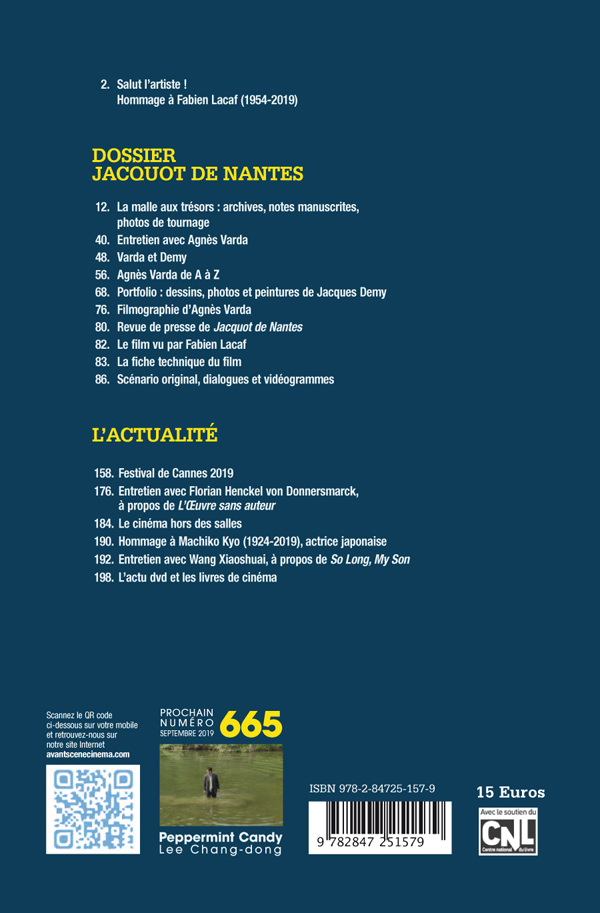Numéro 664 – Jacquot de Nantes d’Agnès Varda
Jacquot de Nantes d’Agnès Varda
Pour commander, cliquez ici
Dossier Jacquot de Nantes d’Agnès Varda
Elle et lui : Agnès Varda et Jacques Demy
Agnès Varda a donc fini par rejoindre son « Jacquot » de Nantes dans leur jolie dernière demeure du cimetière Montparnasse, après un dernier hommage à la Cinémathèque et des funérailles « vardesques », c’est-à-dire pleines d’humour, d’émotion, de fleurs et de fantaisie, délestées de solennité et de componction. Après avoir vécu ensemble, après avoir été séparés par le décès de Jacques, les voilà éternellement réunis.
Quand Agnès Varda et Jacques Demy se rencontrent, en 1958, au Festival du court métrage de Tours, ils sont tous les deux des cinéastes émergents, en devenir. Agnès a réalisé des courts métrages (Ô saisons, ô châteaux…), des documentaires (Du côté de la côte…) et un long métrage remarqué (et remarquable), La Pointe courte, qui mixe déjà audacieusement docu et fiction, le monde tel qu’il est et l’artifice théâtral. Elle est aussi connue comme photographe, ayant notamment travaillé pour le TNP et le Festival d’Avignon. Un brin moins productif à cet instant T de leur rencontre, Jacques a de son côté assisté Georges Rouquier, signé quelques courts métrages documentaires et attend encore de réaliser son premier long.
Sur le plan personnel, cette rencontre est décisive. Varda et Demy se marient peu de temps après, puis ont un fils, Mathieu. Jacques adopte par ailleurs Rosalie, la fillette issue d’une relation précédente entre Agnès et le dramaturge Antoine Bourseiller. Depuis cette rencontre tourangelle, le couple Varda-Demy voguera toute une vie, résistant à tous les aléas (dont l’homosexualité de Jacques), jusqu’à ce que le décès de Demy les sépare en octobre 1990…Trente-deux années de vie à deux, avec les enfants puis petits-enfants, entre la maison rose de la rue Daguerre et le moulin de Noirmoutier, entre les plages de calme (et de sable) et l’agitation des tournages de l’un et de l’autre. Au-delà de leur vie privée et de leur relation intime, la force de ce couple unique réside pour nous cinéphiles dans l’empreinte géante qu’il a laissé dans le cinéma français (et mondial), d’autant plus que cette trace profonde et durable est autant due à Agnès qu’à Jacques. Varda-Demy, c’était un couple moderne, paritaire, égalitaire, féministe, bien avant l’affaire Weinstein et l’ère #metoo, comme une fleur libertaire, pré-soixante-huitarde, éclosant et fleurissant dans la grisaille conservatrice des années De Gaulle-Pompidou. Vu d’aujourd’hui, la filmo Varda est aussi conséquente que celle de Demy, et les deux corpus sont connus dans le monde entier, objets de culte et de rétrospectives régulières, étudiés dans les universités et écoles de cinéma diverses. Aux États-Unis, Les Parapluies de Cherbourg demeure la comédie musicale non hollywoodienne la plus célèbre alors que Cléo de 5 à 7 est considéré comme un film incarnant la Nouvelle Vague française au même titre qu’À bout de souffle, Les Quatre Cents Coups ou Hiroshima mon amour. Côté honneurs, Demy a obtenu la Palme d’or cannoise et le Delluc (les deux pour Les Parapluies de Cherbourg) alors que Varda a collectionné les César, le Delluc, le Lion d’or vénitien et last but not least, une Palme d’honneur et un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. C’est dire si la vie privée, professionnelle, médiatique et artistique d’Agnès Varda et de Jacques Demy se sont continuellement entrelacées. Se pencher sur leurs travaux, c’est aussi mesurer ce qui les lie ou les différencie, c’est tenter de soupeser ce qui a parfois rapproché artistiquement ces deux personnalités irréductibles, comment ils ont pu créer et travailler chacun dans leur coin, ou parfois ensemble et en s’influençant mutuellement, consciemment ou pas.
Transgression des conventions
Varda et Demy ont en commun une approche libre du cinéma, une façon d’accorder le medium à leurs désirs sans se laisser enfermer dans les codes et conventions. Tous les deux ont fait cinéma de tous bois, pratiquant le court, le moyen et le long métrage, le documentaire et la fiction, le noir et blanc et la couleur. Varda a été encore plus loin que Jacques dans l’exploration de toutes les possibilités de son outil puisqu’ayant eu la bonne fortune d’être encore en vie à l’ère numérique, elle a eu le loisir d’expérimenter les nouvelles frontières de la technologie digitale, plutôt dans le sens d’une économie et d’une écologie du cinéma que dans celui d’une surenchère spectaculaire, faisant des films moins chers et à la première personne du singulier, rapprochant ainsi le geste de cinéaste de celui du peintre, du romancier ou de l’essayiste. Après ses débuts consacrés au court métrage et au documentaire, Jacques s’est inscrit dans un écosystème de cinéma plus classique sinon plus conventionnel, celui du long métrage de fiction fabriqué avec des moyens relativement conséquents et des équipes de collaborateurs qui étaient chacun des champions de leur domaine (Claude Evin aux décors, Michel Legrand à la musique…). Si Jacques était cinéaste hollywoodien comparé à Agnès, et si Agnès était auteure libertaire comparée à Jacques, ce dernier témoignait d’une audace et d’une singularité égales à icelle par les thèmes qu’il abordait (le couple désaccordé, l’inceste, les effets de la guerre d’Algérie, les enfants naturels, le père absent, la famille recomposée…) et par le genre qu’il affectionnait (la comédie musicale, les dialogues en chanté…) qui en faisaient un cinéaste prototype unique dans le paysage français. Difficile de trouver dans notre cinéma actuel des réalisateurs qui transgressent autant que Varda et Demy les usages esthétiques, thématiques et dramaturgiques dominants.
Modestes splendeurs
Si Demy a été plus constamment fidèle que Varda au long métrage de fiction et a moins mélangé les genres, tous les deux ont signé à leurs débuts un film marquant qui croisaient les territoires a priori étanches de la fiction et du documentaire : La Pointe courte pour elle, Le Sabotier du Val de Loire pour lui, deux splendeurs modestes en noir et blanc. Dans La Pointe courte, Varda alterne l’introspection d’un couple en crise, joué par des acteurs professionnels (Silvia Monfort et Philippe Noiret), et la chronique documentaire d’un quartier de pêcheurs à Sète en voie de paupérisation. Elle juxtapose ainsi de façon très moderne l’artifice théâtral et le monde tel qu’il est et s’offre naturellement au regard. Dans Le Sabotier…, Demy aussi filme le monde tel qu’il est à travers la journée d’un artisan fabricant de sabots. En bon élève qui a retenu les leçons du grand Georges Rouquier, Demy se montre attentif aux gestes, aux corps et aux lieux de ce modeste vieillard et de sa femme, soucieux de garder une trace de ce couple qui incarne un monde en train de disparaître. Pur documentaire ? Par la matière qu’il filme, oui. Par la façon dont il la cadre, la rythme, scandant les moments d’une journée-type, non. Comme Varda, Demy ne s’est pas contenté de planter sa caméra dans un milieu pittoresque tel un reporter télé ordinaire, il a opéré des choix de cadre, de lumière, de montage, de structure… bref, il a fait œuvre de cinéaste.

Rose et noir
Comme La Pointe courte et Le Sabotier du Val de Loire, les premiers films de Varda et Demy étaient en noir et blanc (Cléo de 5 à 7, Lola, La Baie des anges…), mais la couleur ne perdait rien pour attendre et le couple va faire flamber la gamme chromatique avec Le Bonheur (1965) pour Agnès et le fameux dyptique Les Parapluies de Cherbourg (1964)/Les Demoiselles de Rochefort (1967) pour Jacques. Dans ces trois films, les couleurs sont exhibées, volontairement artificielles, poussées vers la saturation, quasiment chorégraphiées, dans une optique fondamentalement antinaturaliste mais au service de vérités émotionnelles et humaines – y compris quand ces vérités atteignent une certaine noirceur. Ainsi, tant dans Les Parapluies… que dans Le Bonheur, les couleurs pètent, c’est une symphonie de roses, d’oranges, de rouges, de bleus qui répand la colorimétrie ontologique des fleurs et de la nature à tout ce qui est fabriqué par l’homme : vêtements, voitures, objets, bâtiments, coiffures. Au cinéma, la couleur est souvent associée à une certaine gaité, et les drames sont plutôt traités en noir et blanc ou dans des teintes monochromes sombres. Dans Le Bonheur, le polychromatisme s’accorde parfaitement au sentiment polyamoureux du personnage masculin (joué par Jean-Claude « Thierry la Fronde » Drouot) qui ne voit aucun drame et nul inconvénient à avoir deux femmes. Mais l’épouse « légitime » ne l’entend pas ainsi et souffre de la situation jusqu’à la tragédie. Les teintes printanières du film apparaissent soudainement comme un leurre mortel en regard de ce drame. La couleur ne peut rien face à la cruauté que les humains s’infligent, volontairement ou pas. Même contraste entre la vivacité des coloris et la tristesse des sentiments exprimés dans Les Parapluies de Cherbourg. Les parapluies colorés ne protègent pas de l’averse de l’éloignement et du temps qui fanent les plus belles romances, des aventures amoureuses qu’on laisse échapper, de la guerre qui sépare les amants. Le Bonheur et Les Parapluies… sont des dragées au poivre, des friandises d’Halloween fourrées aux lames de rasoir, deux films où le sucre des couleurs fait ressortir encore plus violemment une amertume ou une cruauté fondamentales. Ce n’est que dans Les Demoiselles de Rochefort que la vitalité chromatique sera parfaitement accordée aux sentiments amoureux qui enfin coïncideront – mais non sans être passés par des détours labyrinthiques et mélancoliques où les amants prédestinés auraient pu ne jamais se rencontrer.
California dream
Varda et Demy, ce sont aussi des citoyens portuaires. Elle a grandi à Sète, il a poussé à Nantes, proximité du grand large qui a marqué leurs imaginaires et leurs œuvres. De Cherbourg ou Rochefort aux « plages d’Agnès », l’eau et la possibilité de l’ailleurs rodent toujours dans les films de « Vardemy ». Les marins, les forains, les fiancés partis en Amérique ou venus de là-bas hantent particulièrement l’œuvre de Jacques. Nulle surprise dès lors à ce que le couple parte vraiment à l’autre bout du monde (en l’occurrence en Californie) pour prendre concrètement la mesure de ses rêves et fantasmes. Demy y réalise Model shop (1969), une suite de Lola : Anouk Aimée/Lola débarque à Los Angeles pour y retrouver le fiancé qui la quitte à la fin de Lola. À l’arrivée, pas de fiancé mais l’ennui, la solitude, la dépression – à peine égayés par une relation sans espoir avec un beau Californien (joué par Gary Lockwood, astronaute de 2001, alors qu’Harrison Ford avait passé des essais pour ce rôle !). Model shop est un film triste mais aussi extrêmement moderne, qui semble prophétiser la gueule de bois qui suivra la fin des illusions des sixties et qui annonce les road movies neurasthéniques d’un Wim Wenders (Antonioni n’est pas loin non plus). Comme dans Les Parapluies… ou Le Bonheur, les teintes chaudes de la Californie, ses belles voitures chromées et ses palmiers contrastent avec le bleu sombre de la psyché de Lola. En pleine époque « Summer of love », Demy, éternel mélancolique, dépeint un « Summer of loss ». Réussite artistique, Model shop sera un échec commercial, ce qui ne contribuera pas à égayer son auteur ni à lui donner envie de prolonger son expérience américaine. Contrairement à son époux, Agnès Varda s’adapte bien à la Californie et prend cinématographiquement le pouls de cette région et de son époque là où Demy a fait plutôt figure d’outsider européen. Dans Lions love (1969), elle dépeint un phalanstère (une fille, deux hommes) qui vit d’amour et d’eau fraîche (de création artistique et de joints aussi), refuse le travail de 9 à 5 et préfère paresser, vivre ses rêves, accorder son existence à ses désirs. Les cheveux sont longs, les vêtements bariolés (ou absents !), pour une dolce vita qui remet en cause le capitalisme, le productivisme et tout le rêve américain tel que vanté par les années Eisenhower/Johnson. Varda épouse cet hédonisme mais n’hésite pas non plus à le questionner, à mettre en doute sa viabilité à long terme, sa capacité à élever des enfants. Elle plonge à fond dans le rêve hippie californien et les questions qu’il reformule sur le couple, l’amour, la famille, le travail, mais sans en être dupe, en gardant une distance critique européenne. Il n’empêche, on sent que le California way of life sied mieux à Agnès qu’à Jacques. Elle profite de son temps californien pour aller filmer les Black Panthers, curieuse et branchée sur les mouvements d’émancipation de son temps. Ni propagandiste ni critique, Black Panthers (1968) est une immersion qui laisse le spectateur libre de son jugement, une observation de ce qui travaille en profondeur la société américaine de l’époque. Des années plus tard, dans Documenteur (1981), Varda signera une sorte d’autofiction qui portera un regard plus désenchanté sur ses années californiennes, comme si la mélancolie de Model shop et de Jacques l’avait rattrapée.
Mise en crise du patriarcat
Dans les années 1970-80, Agnès Varda et Jacques Demy suivent chacun leur route de cinéma tout en restant très complices. Varda est ainsi souvent présente sur les tournages de Jacques. Fidèle à son goût du cinéma comme porte ouverte vers l’imaginaire, la fantasmagorie, la stylisation, Demy enchaîne des films magnifiques, dont certains connaissent le succès (Peau d’âne), d’autres l’échec (Lady Oscar, Parking…), d’autres l’entre-deux mitigé (Une chambre en ville, Trois Places pour le 26…). Ce qui caractérise les films de Demy, c’est leur éloignement du réalisme. Peau d’âne est adapté d’un conte, Lady Oscar ou Le Joueur de flûte sont des films historiques en costumes, L’Événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune est plus ancré dans le présent et le quotidien mais développe un pitch totalement irréaliste puisqu’il s’agit d’un homme qui tombe enceint ! Demy aime partir voyager dans des univers imaginaires mais ce goût de l’artifice est toujours au service du traitement de thématiques réalistes : le couple, la famille, la filiation, l’inceste, les sentiments, la crise du patriarcat, voire l’absence totale du père… Demy conjugue toujours goût du spectacle, vérité humaine et progressisme. De son côté, Varda suit un chemin plus atypique. Bien que célèbre et installée dans le milieu du cinéma, elle continue à user du cinéma comme bon lui semble, alternant courts métrages (Réponses de femmes, Plaisir d’amour en Iran, Ulysse, T’as de beaux escaliers tu sais…), documentaires (Daguerréotypes, Mur murs, Les Dites cariatides…) et longs métrages de fiction (L’Une chante l’autre pas, Sans toit ni loi…), éternellement non conforme au parcours usuel des cinéastes qui durent. Si Agnès partage avec Jacques le goût de la fantaisie, ses films penchent plus vers le réalisme et les questions sociétales de son temps. Ainsi, L’une chante l’autre pas est une chronique ample et nuancée du féminisme à travers trente ans de la vie de deux amies, alors que Sans toit ni loi brosse avec âpreté le tableau de la précarité. Deux films qui n’ont rien perdu de leur pertinence avec le temps puisque le féminisme et la fragilité économique sont deux questions de plus en plus prégnantes dans nos sociétés et dans les titres de l’actu. C’est sans doute là le trait qui distingue le plus le cinéma de Varda et celui de Demy dans ces années 75-90 : elle penche plus vers le collectif, le sociétal (même si elle évoque aussi l’amour et l’amitié), alors que lui reste plutôt proche de l’intime et des sentiments (même si on le sent également habité par les barrières de classes sociales). Ils se rejoignent par leur féminisme, qu’il soit proclamé (Varda) ou en filigrane (Demy), remettant en cause le patriarcat dominant la réalité et les esprits de l’époque.
Ni avec toi ni sans toi
Jacques Demy décède en 1990. Pour autant, le couple Varda-Demy continue d’exister après cette disparition. D’abord parce que Jacques Demy reste constamment présent à l’esprit et au cœur d’Agnès Varda. Ensuite, parce que ce lien indéfectible qui se poursuit après la mort, Agnès le fait vivre dans son œuvre. Il n’y a pas un de ses films, pas une de ses interviews qui ne mentionnent Jacques, son travail, leurs souvenirs communs. Cette fusion affective et artistique a bien sûr trouvé sa traduction évidente dans les trois films que Varda a consacrés à Demy : Jacquot de Nantes, Les Demoiselles ont eu 25 ans et L’Univers de Jacques Demy. Trois films, trois registres différents : une évocation biographique avec acteurs et décors comme dans une fiction, un retour documentaire sur un tournage et un film mythiques, et un documentaire plus classique sur le mode « sa vie son œuvre ». Avec Jacquot…, Varda parle de Demy à la Demy, en mixant réalité et fiction, éléments biographiques et imaginaire, réalisme et enchantement – ce qui est somme toute logique puisque Varda n’ayant pas connu Demy enfant, il est normal qu’elle imagine, recrée, invente des processus d’incarnation. Avec Les Demoiselles…, Varda parle de Demy à la Varda : elle entre dans le cinéma de Demy et lui offre un superbe prolongement documentaire, inventant en quelque sorte le making of a posteriori. Du temps concentré de Cléo de 5 à 7, elle passe ici au temps retrouvé proustien qui se mesure à l’échelle d’une vie. Enfin, avec L’Univers de Jacques Demy, Varda tente de cerner de façon plus classique ce qui constituait l’art de Demy, un peu comme si elle avait ajouté un chapitre à la fameuse série de portraits de cinéastes par d’autres cinéastes, Cinéma de notre temps.
Avec ces trois films, Agnès Varda atteste, boucle, persiste et signe le lien amoureux, existentiel et artistique qu’elle a entretenu avec Jacques Demy et poursuivi après son trépas. Un lien qui est désormais éternel. Maintenant qu’Agnès nous a également quittés, les générations de cinéphiles continueront d’admirer l’œuvre de Varda, l’œuvre de Demy et de soupeser les points qui les rapprochent ou les séparent. On continuera de voir ou revoir Les Demoiselles de 5 à 7, Les Parapluies de la Pointe courte, Trois places pour le bonheur, Les Glaneurs et la glaneuse de Cherbourg, Mur murs en ville ou Une Chambre sans toit ni loi… Tant il est vrai que ces deux œuvres coexistent à la fois de façon autonome et en regard l’une de l’autre et pourraient se dire, tels les amants de La Femme d’à côté de François Truffaut : ni avec toi, ni sans toi. n
Serge Kaganski