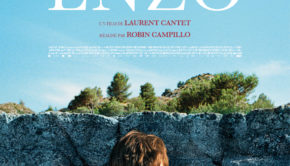La Mission de Paul Greengrass
Naissance d’une nation
Le western est un genre paradoxal. D’un côté, il se range du côté des survivants, tant son taux de natalité est tombé dans des abymes pitoyables comparé à la vigueur qui était la sienne à l’époque où Ford, Hawks, Hathaway, Daves ou Mann étaient aux commandes d’Hollywood (le sort de la comédie musicale est encore plus alarmant). Mais de l’autre il continue à produire bon an mal an quelques pépites qui nous concernent d’autant plus qu’il n’est pas possible de prendre les films comme ils viennent, au premier degré. Car c’est toute l’histoire du cinéma qui se déroule avec eux, et avec elle une certaine conception de l’Amérique. Nul mieux que le western ne sait parler des mutations de l’âme américaine, même si l’action se déroule dans la grande majorité des cas peu ou prou à la même époque et dans les mêmes lieux.
Dans le cas qui nous intéresse ici, c’est le Texas du début des années 1870 que nous arpentons sans relâche, alors que les braises de la guerre de Sécession (rappelons que le Texas était du mauvais côté) ne sont pas encore éteintes. Mais viennent se juxtaposer la question des retombées de l’esclavage et celle des guerres indiennes. Du lourd, on en conviendra. Le film ne cherche pas nécessairement à se survendre ni à étaler en permanence la hauteur de ses objectifs, mais c’est manifestement une tranche assez épaisse de l’Histoire de l’Amérique qui nous est servie. Le personnage principal, qu’incarne un Tom Hanks irréprochable, est un ancien imprimeur, qui après avoir été démobilisé et en ayant peu de désir de regagner ses pénates (sa femme est morte), a choisi de sillonner le pays pour lire les journaux à un public souvent illettré et très majoritairement ignorant de la marche du monde. Une profession sans doute inédite au pays du western, synonyme d’une vraie précarité, au milieu d’un monde qui peine à se reconstituer et à s’inventer de nouvelles valeurs. On le mesure au détour d’une scène en mesurant la place qu’occupe l’armée, y compris dans le domaine administratif. La rigidité des règlements en place n’a à cet égard rien à envier à celle des nôtres. Mais nous apercevons en filigrane la question déjà épineuse de la place de l’État fédéral dans un pays qui ne veut pas renoncer à ses particularités locales…
La Mission est un road movie, qui permet aux héros de traverser le pays et de rencontrer à cette occasion différents personnages qui au final forment un panel assez généreux des différentes populations du cru et des problématiques qui s’y attachent. À l’instar de notre journaliste nomade, nous ne faisons que les croiser. À l’exception notable d’une petite fille de dix ans, qui va l’accompagner tout au long de son périple, une petite blonde d’origine allemande, enlevée aux siens plusieurs années plus tôt par les Indiens kiowas. Une pratique qui a connu quelques échos au cinéma. On se souvient des va-et-vient de Jack Crabb, alias Dustin Hoffman entre le monde des Blancs et les tribus sioux dans Little Big Man, d’Arthur Penn. Mais c’est bien sûr La Prisonnière du désert (l’un des plus beaux films de John Ford, dont la filmo compte pourtant plus d’un chef-d’œuvre) qui nous revient en permanence (même si la temporalité n’est pas la même, Wayne mettant des années à retrouver l’enfant devenu adulte), Greengrass ne se privant pas de nous adresser au détour d’un plan un clin d’œil pictural et référenciel. Mais nous pensons aussi bien sûr à L’Enfant sauvage. Nous ne sommes pas dans l’Aveyron, mais la relation entre l’enfant qui doit totalement changer de monde, y compris mentalement, et celui qui entreprend de l’apprivoiser (le mot est sans doute un peu fort, mais c’est vraiment celui qui convient) est un peu la même, qui évolue d’une hostilité irréductible à un sentiment affectueux.
Le Texas n’est pas véritablement à l’Ouest de l’Amérique, mais La Mission est bel et bien un western. D’ailleurs, le tournage s’est déroulé au Nouveau Mexique, autour de Santa Fe. Un western traditionnel à bien des égards, qui renoue avec les grandes sagas du genre, à l’époque, dans les années 1940 et 1950, où Hollywood en produisait des quantités industrielles sans se poser de questions inutiles (et très souvent avec une réussite incontestable). Paysages envoûtants (et parfois effrayants), quête initiatique, fragilité de l’existence : toutes les composantes du western sont réunies. Mais Paul Greengrass n’essaye pas de faire le malin ou de tirer la couverture à lui plus que de raison, comme le fait régulièrement (et avec talent) Quentin Tarantino, dont le cinéma est référentiel par essence. Pas de traces outrancières ici de la révolution baroque opérée par le western spaghetti et ses succédanés. Greengrass, qui a toujours proclamé avoir hérité du cinéma du réel (sauf bien entendu dans la série des Jason Bourne) n’a pas voulu faire exception en visitant un monde qui n’existe plus. Chez lui, contrairement à certains westerns flamboyants de l’âge d’or, pas d’héroïnes avec du rouge à lèvres ou de cavaliers à la chemise fraichement repassée. La nature est agressive et le corps, à l’instar de l’esprit, doit se plier à ses exigences.
Mais Paul Greengrass (dont il faut rappeler qu’il est sujet britannique, mais la liste est longue des sujets de Sa Gracieuse Majesté qui ont apporté leur pierre à l’édifice westernien) était-il le mieux placé pour conduire cette aventure ? On a pu s’étonner dans un premier temps de le retrouver sur Netflix. Mais le film avait pour vocation de sortir en salle (et cela a été le cas outre-Atlantique avant que les cinémas ne ferment leurs portes). N’oublions pas non plus que l’opus précédent du cinéaste a été directement diffusé sur la plate-forme : Un 22 juillet, qui relate la tuerie d’Uttoya, perpétrée par un néo-nazi norvégien, était parfaitement dans les cordes du cinéaste, et c’est une réussite totale… Et d’ailleurs La Mission n’est arrivé à Greengrass qu’après être passée entre plusieurs mains… Issu du documentaire, le cinéaste s’est toujours appliqué à effacer la distance entre le spectateur et ce qui lui était donné à voir. Relatant les épisodes les plus explosifs de l’Histoire contemporaine (le bain de sang lors de la manifestation indépendantiste en Irlande du Nord de janvier 1972, le calvaire des passagers du vol 93 détourné par des terroristes du 11-Septembre, l’inconfort des soldats américains dans l’Irak d’après Saddam, l’arraisonnement par des pirates africains du bateau du capitaine Phillips, le massacre d’Uttoya, etc.), Paul Greengrass a créé une façon bien à lui de nous faire entrer dans ses fictions comme si nous étions au cœur de l’action. Ce qui nécessite une réactivité sans pareille et un goût marqué pour les caméras portées. En rétrogradant d’un siècle, en s’aventurant sur un terrain cinématographique inédit, il était sans doute risqué de ne pas vouloir changer de braquet. La mise en scène de La Mission est à cet égard presque apaisée, du moins plus classique, qui ne se prive pas de beaux mouvements de grue bien enveloppants mettant les paysages en valeur. Et l’on se surprend ici ou là à ressentir comme les effets d’une certaine lenteur qui était jusque-là étrangère au cinéaste. Les autres films de Greengrass se focalisant sur des accès soudains de violence, s’étalent sur quelques heures, au plus sur quelques jours. Le temps de cette Mission se déroule évidemment à un autre rythme…
Et pourtant le film est signé par l’auteur de Vol 93. Au-delà du spectacle, c’est bel et bien un commentaire sur les mutations sociales et idéologiques d’un pays à un moment donné qui nous est livré. La géopolitique n’est jamais loin. Les pures scènes d’action ne sont sans doute pas aussi présentes que d’habitude (encore que celle du guet-apens, dont on ne jurerait pas d’entrée de jeu que nos héros se sortiront, reste l’un des moments forts du film) mais l’empathie du cinéaste pour des êtres en souffrance placés face à un danger mortel reste la même.
Faut-il préciser que Tom Hanks est parfait ? Celui qui avait été le capitaine Phillips du film éponyme, devient une nouvelle fois un héros par nécessité plus que par conviction. Connaissant son positionnement politique, démocrate bon teint, il n’est pas interdit de voir en lui comme l’héritier d’un Burt Lancaster ou d’un Gregory Peck, qui ont régulièrement veillé à ce qu’une certaine éthique veille sur les films dont ils étaient les vedettes. Le tandem que Hanks forme avec Helena Zengel, la petite fille (une authentique berlinoise) restera dans les annales. À l’opposé de ceux qui se sont d’abord employés à redéfinir la grammaire et l’environnement du western, à la suite de Sergio Leone, Greengrass semble s’être d’abord régalé à peindre l’intime, tout en cherchant à maintenir un équilibre précis entre les faits et l’émotion.
Ce n’est évidemment pas un hasard si son héros n’est pas un outlaw intrépide ni un rancher aux ambitions hégémoniques. C’est comme beaucoup d’autres un homme à la croisée des chemins, sorti de la guerre en ayant tout perdu. Un homme fracassé par le passé, qui retrouve finalement une raison d’être en portant secours à une gamine tout aussi paumée que lui. Il gagne (chichement) sa vie en transportant les nouvelles, une profession on en conviendra peu représentée dans les westerns. Mais cela lui permet d’être aussi le porte-parole de Greengrass, son alter-ego, qui porte un regard concerné et pour le moins critique sur le monde. Dans un pays où l’illettrisme le disputait à l’ignorance et aux passions troubles, mettre en lumière cet ancêtre des stars de CNN est une façon de montrer que l’Amérique était une nation en devenir, éclatée en de multiples groupes hostiles. Défenseur passionné de l’information et de la démocratie (mais ne vont-elles pas ensemble ?), notre homme est bien l’un de ces hussards noirs de la république…
Difficile de croire à cet égard que Greengrass n’ait pas eu la moindre arrière-pensée et que nombre de ses remarques ne soient de fait dirigées contre l’Amérique de Trump. La communauté raciste et refermée sur elle-même qui se met en travers du chemin de notre homme, la réflexion sur l’émancipation des minorités et bien sûr les « fake news » que l’on dénonce sont autant de pistes qui tracent une ligne droite jusqu’à aujourd’hui. Quitte à risquer de prendre des coups (et parfois pire) Kidd (Tom Hanks) pousse ostensiblement son public à se faire sa propre opinion après avoir entendu les nouvelles colportées. Une belle définition de la liberté et du libre-arbitre pour ce pays qui parfois (le 6 janvier dernier devant le Capitole par exemple) donne le sentiment d’être tenté par un fanatisme tribal…
Yves Alion
News of the World. Réal. : Paul Greengrass. Scn. : Luke Davies et Paul Greengrass, d’après le roman News of the World de Paulette Jiles. Dir. Phot. : Dariusz Wolski. Mus. : James Newton Howard. Prod. : Gary Goetzman, Gregory Goodman, Tom Hanks et Gail Mutrux pour Perfect World Pictures et Playtone. Int. : Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon, Mare Winningham, Elizabeth Marvel. Durée : 1h59. Disponible sur Netflix.